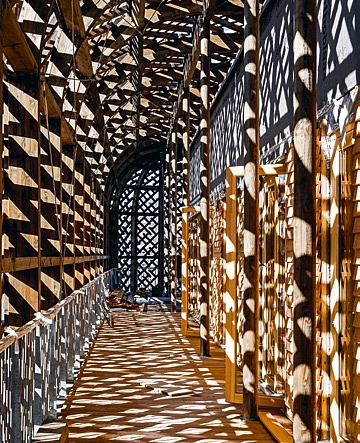....
. ![]() Bâtiments
et Quartiers durables franciliens
Bâtiments
et Quartiers durables franciliens
.
200
projets pour transformer le territoire
.
(1)
Les démarches
Les quatre totems des démarches
Logements
: Les Pierres Sauvages - Pantin (93)
...
Avec 200 projets accompagnés depuis 2017, les démarches
Bâtiments et Quartiers durables franciliens sont désormais
incontournables dans l’écosystème de l’immobilier
régional. De nombreuses maîtrises d’ouvrage publiques
comme privées rejoignent Ekopolis pour améliorer la qualité
environnementale de leurs projets, tout en faisant progresser les connaissances
et les pratiques de toutes et tous. Co-construit et animé avec
des professionnels engagés - maîtres d’ouvrage, architectes,
paysagistes, urbanistes, bureaux d’études et entreprises
du bâtiment -, l’accompagnement BDF et QDF pousse chaque équipe
à trouver ensemble les solutions qui viendront améliorer
les performances
environnementales et la valeur sociétale de son projet, tout en
préservant qualité d’usage, qualité architecturale
et équilibre économique.
C’est là toute la puissance de l’intelligence collective
! Jacques Baudrier, Président d’Ekopolis, Adjoint à
la Maire de Paris
en charge du logement et de la transition écologique du bâti
; Véronique Pappe, Directrice d’Ekopolis
| Les démarches | |||||||||||
| Des démarches qui transforment l’Île-de-France Cela
se traduit concrètement par une priorité donnée
à la réhabilitation plutôt qu’à
la démolition, au bioclimatisme plutôt qu’à
la climatisation, à la sobriété des matériaux
et des équipements, à une gestion raisonnée
de l’eau… Bref, une approche low-tech qui, grâce
à une méthode éprouvée et un petit
apport supplémentaire de matière grise dès
l’amont des projets, permet d’économiser les
ressources et de garantir le confort des usagers. BDF et QDF : l’intelligence collective en action Avec
plus de 200 opérations de bâtiments et une dizaine
à l’échelle de l’aménagement,
les démarches portées par Ekopolis participent activement
à la transformation des projets franciliens en construction
neuve, réhabilitation et renouvellement urbain. Les Commissions publiques Incarnation
de la dimension participative des démarches, les Commissions
publiques sont organisées tous les mois dans des lieux
variés. |
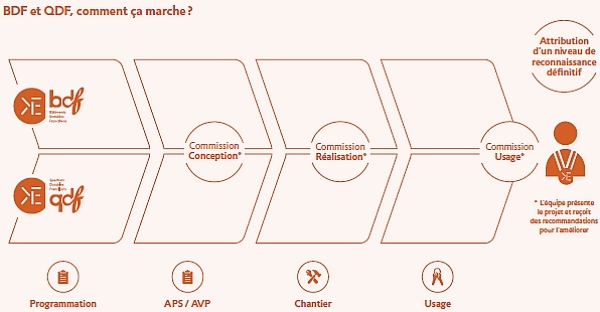 L’opération est accompagnée dès la programmation ou la conception - au plus tard à l’APS -, et jusqu’à deux ans après la livraison. Pendant toute cette période, Ekopolis est aux côtés de l’équipe projet et l’aide, étape par étape, à mettre en œuvre au mieux la démarche. |
||||||||||
| La
démarche BDF, c’est une véritable chance de
faire collaborer tous les acteurs d’un projet. Fabien Gantois, Architecte, vice-président de l’Ordre national des architectes |
|||||||||||
| Chiffres
2024 200 Opérations BDF - 10 Opérations QDF 1 800 000 m² Surface de plancher (SDP) |
|||||||||||
|
|
|||||||||||
| La
Commission a été l’occasion de prouver, devant
tous les professionnels du secteur, que notre parti-pris de renoncer à la démolition avait du sens sur le plan environnemental et financier ! Sarah Tartarin, Ingénieure environnement et gérante, GERA’nium |
|||||||||||
| Opérations BDF Types
de maîtrise d’ouvrage : 53% Maîtrise d’ouvrage
publique ; 34% Maîtrise d’ouvrage privée ;
13% Bailleurs sociaux
Types
de travaux : 49% Construction neuve ; 22% Réhabilitation
; 17% Mixte
Types
de programme : 12% Démolition-Reconstruction ; 50%
Équipements ; 34% Logements ; 16% Tertiaire et autres |
|||||||||||
| .. |
|||||||||||
 |
Réhabilitation : Les
ressources ne sont
© Tom Klapisz |
Réhabilitation
: L’étalement
urbain contribue au changement climatique et au déclin
de la biodiversité. En réduisant les capacités
de stockage de carbone du sol et l’infiltration des eaux
pluviales, l’artificialisation augmente les risques naturels,
dont les phénomènes d’îlots de chaleur
urbains. Elle fragmente et détruit les milieux naturels. Bioclimatisme
: Quel
que soit le scénario ou les projections climatiques pris
en compte pour les années à venir, les vagues de
chaleur vont s’intensifier et se multiplier. Ces périodes
extrêmes ont un impact direct sur notre santé, voire
la survie, notamment des personnes fragiles ou surexposées.
L’Île-de-France, par ses fortes densités bâties
et de population, est particulièrement concernée.
L’installation de systèmes de climatisation ou de
rafraîchissement actif est à envisager en dernier
recours ou dans des zones refuge collectives : ils aggravent le
phénomène d’îlot de chaleur en diffusant
de l’air chaud, ils sont consommateurs d’énergie
et ils utilisent des fluides frigorigènes composés
de gaz à effet de serre. Sobriété
matière : Le
secteur du bâtiment représente 46% des émissions
de GES de l’Île-de-France et la construction représente
60% de l’empreinte carbone d’un bâtiment neuf
sur l’ensemble de son cycle de vie. Les chantiers de bâtiments
et travaux publics sont les principaux producteurs de déchets.
Il y a donc un enjeu à mettre en œuvre des matériaux
économes en matières premières rares, épuisables
et fabriquées à partir de combustibles fossiles.
Il s’agit des matériaux biosourcés - composés
de ressources d’origine végétale ou animale
: bois, lin, chanvre, paille, laine… -, géosourcés
- terre crue, pierre… - et de réemploi. Zéro
rejet : L’imperméabilisation
des sols a plusieurs impacts : elle limite l’infiltration
de l’eau dans les sols, et donc la recharge des nappes phréatiques,
et oblitère les conditions d’un sol vivant ; elle
augmente le ruissellement des eaux sur les voiries, et elle accentue
les risques d’inondations et de surcharge des réseaux
d’évacuations. À fortiori lors des épisodes
de fortes pluies, de plus en plus fréquents et intenses
en volume et en durée. Il y a donc un enjeu à concevoir
des aménagements permettant de gérer les eaux pluviales
à la parcelle, au plus près du point de chute, et
sans rejet aux réseaux. Campus Muséum Brunoy (91) © Groupe-6 Architectes (image KDSL) |
|||||||||
|
|
Bioclimatisme : C’est
important de créer
Médiathèque
James Baldwin |
||||||||||
 |
Sobriété matière : À
l’échelle du projet, le coût de fourniture
de la botte de paille est quasi négligeable. Par contre,
le besoin de main d’œuvre est bien plus important et
représente les deux tiers du coût des travaux. En
tant que maître d’ouvrage public, c’est une
vraie opportunité pour mobiliser des chantiers Rénovation
de la maternelle Bois-Perrier, Rosny-sous-Bois (93) |
||||||||||
 |
|||||||||||
| Zéro rejet : En
temps de pluie, de nombreux réseaux d’assainissement
sont surchargés et rejettent régulièrement
des eaux polluées dans les milieux naturels, notamment
la Seine. Développer des dispositifs de gestion des eaux
pluviales à la source permet de réduire les volumes
d’eau à gérer par les réseaux d’assainissement. |
|||||||||||
..... Construction
de 66 logements dont 22 sociaux, un centre municipal de santé,
des commerces et locaux d’activités, 58 emplacements |
|||||||||||
| Figure
de proue du quartier de la gare de Pantin, dont la future ZAC
est engagée dans la démarche Quartiers durables
franciliens, le projet Les Pierres Sauvages convainc
par sa programmation qui fait écho aux exigences environnementales
de la Ville, et répond au déficit de logements.
On y retrouve des logements sociaux et en accession, des commerces,
ainsi que le nouveau Centre Municipal de Santé Sainte-Marguerite,
et des cabinets libéraux au rez-de-chaussée, destinés
à couvrir une partie des besoins du territoire. |
|
||||||||||
| Surface
de plancher : 6 637 m² - Maîtrise d’ouvrage
: REI Habitat Architectes : Des Clics et des Calques, Palast Assistance à maîtrise d’ouvrage : Athlance, Remake, ARP Astrance Bureaux d’études techniques : Grue, EVP, IPC, BCA, Aïda, AGi2D Entreprises : Léon Grosse, Construire en végétal, ACDF, MJ Pierres Accompagnement BDF : François Vibert - Montant travaux : 18 M€ HT Phase : Livraison 2025 - Reconnaissance (V2.3) : Or en phase conception |
|||||||||||
| Évaluation BDF Gestion
de projet : 92% - Territoire et site : 86% - Solidaire : 83% -
Energie : 84% |
|||||||||||
|
|||||||||||