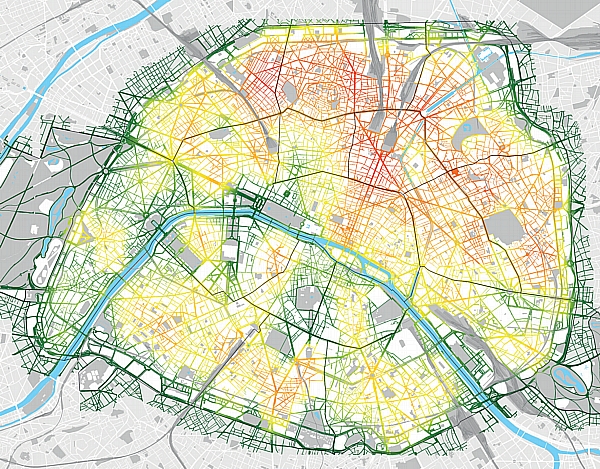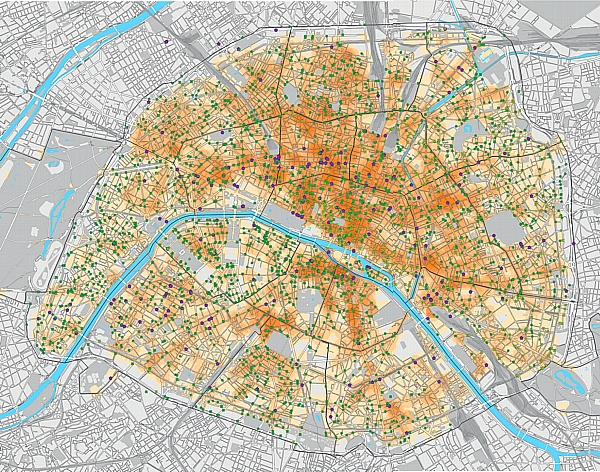....
. ![]() Atlas
des usages et des potentiels du réseau parisien d'eau non potable
Atlas
des usages et des potentiels du réseau parisien d'eau non potable
.
(2) La propreté et l’assainissement
...
La présence d’un double réseau d’eau - potable
et non potable - est l’héritage de la pensée hygiéniste
et des travaux haussmanniens.
Les 1 700 km de réseau d’eau non potable contribuent aujourd’hui
à l’entretien du réseau d’assainissement, au
nettoiement de la voirie,
à l’arrosage de plantations, et à la trame d’eau
de parcs, jardins, et bois de Paris. En 2012, le Conseil de Paris a décidé
du maintien et de l’optimisation de ce réseau, et a approuvé,
en 2015, un premier schéma directeur des usages et du réseau.
L’anticipation d’un nouveau schéma directeur 2022-2034
a conduit la Direction de la Propreté et de l’Eau - DPE -
et Eau de Paris à rechercher l’adéquation du
niveau de service
pour les usages de l’eau non potable avec un niveau d’investissement
soutenable.
| La propreté et l’assainissement | ||||||||||||
| Le
réseau d’ENP joue un rôle majeur, historique,
dans la gestion de la propreté Les bouches de lavage (BL) Les
BL permettent d’assurer un nettoyage des caniveaux et des
trottoirs considéré plus efficace en temps et en
résultat - urine, déjections canines, poussière
et pollution… - que le nettoyage à sec. Comme le
rappelle l’étude STEA/Prolog de 2019, leur utilisation
est aussi ancrée dans les mentalités des riverains
et de leur perception de la propreté. Les échanges
sur le quartier test du XVIIIe arrondissement, dans le cadre de
l’élaboration de l’atlas, confirment qu’il
arrive que des usagers privés ouvrent, sans autorisation
les BL, pour compléter le nettoyage de leurs trottoirs,
voire pour rafraîchir l’espace public en période
de forte chaleur. Les
BL sont particulièrement nécessaires pour le nettoyage
des biefs stationnés que les engins de nettoiement ne peuvent
traiter aussi efficacement que les biefs non stationnés.
Localement elles peuvent aussi servir au remplissage d’engins
de nettoiement de trottoirs (ENT), en complément des BRT,
et plus ponctuellement pour le nettoyage : véhicules de
service, travaux de voirie. Les bouches de remplissage de tonne (BRT) Le
parc des BRT référencées par Eau de Paris
compte 547 unités, dont 231 alimentées par le réseau
de distribution : diamètre inférieur à 300
mm. Selon les données transmises au STTP par 14 divisions
territoriales, dans le cadre de l’étude de 2019,
sur un total de 410 BRT, 130 ne seraient plus utilisables, car
leur emplacement n’est plus sécurisé au regard
de l’évolution de circulation à Paris : pistes
cyclables, voies de bus… Les réservoirs de chasse (RC) Les RC peuvent constituer une assez forte contrainte dans l’optique d’une rationalisation du réseau ENP (1), du fait notamment de leur rôle important dans le curage régulier des petites lignes. (1) - STEA/Prolog Ingénierie, Étude sur l’adéquation du niveau de service pour les usages de l’eau non potable avec un niveau d’investissement soutenable - Phase 1 : État des lieux du patrimoine et des usages, 2019, p. 11. Le parc des RC, plus de 6 200 à l’origine, a été condamné à 57 % dans les années 80. Compte tenu des effets subits - encrassement, concentration de graisse, développement de nuisibles, mauvaises odeurs, conditions de travail dégradées… -, le nombre optimal avait été fixé à 2 700 pour la modernisation des RC sur la période 1999-2004. À l’origine, un RC se vidait environ toutes les 4 heures, l’objectif était de limiter le volume à une chasse/jour et de condamner des RC jugés inutiles. Une chasse de 5 m³/ jour pour 2 700 RC aurait dû consommer environ 13 500 m³/j. mais c’est finalement 3 370 m³/j qui ont été atteints en 2009, à cause de multiples dysfonctionnements de la temporisation, soit 5 % de la consommation totale sur le réseau et une baisse de 98 % en 10 ans (2). (2)
- Apur, Étude sur le devenir du réseau d’eau
non potable. Partie 1 : Analyse et diagnostic, Le maintien en bon état de fonctionnement d’un parc de 2 700 RC avait été considéré comme nécessaire en 2012. En 2020, sur les 2 683 prévus à conserver, 1 684 fonctionnent et 999, dont 167 très utiles, sont en attente de réparation. La perspective d’une réduction à 2 274, sur la base des RC considérés comme utiles et très utiles a été construite à partir d’un premier retour des services de la DPE. Dans le cadre de l’atlas, il s’est avéré utile de croiser cette cible avec d’autres données de surface - concentration de souillure, répartition des restaurants, donc des bacs à graisse - et de sous-sol : tapis de graisse en égouts. La
baisse des RC utiles entre la fin du XXe siècle
et le XIXe siècle est explicable par la forte présence
de sable due au macadam usé, les matières organiques
sur chaussée, et l’augmentation de la consommation
domestique d’eau. |
|
|||||||||||
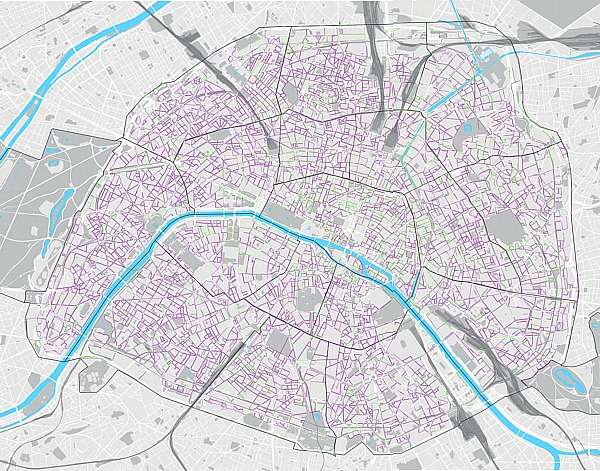 |
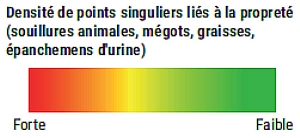 Sources : Apur, DPE, DEVE, Eau de Paris |
Méthodologie cartographique Cette carte de densité - carreau de 25 m x 25 m - est construite à partir des 57 444 points de signalement relevés par les utilisateurs de l’application Dans Ma Rue entre 2019 et 2021. N’ont été sélectionnés que les points liés à la propreté de l’espace public, à savoir les souillures animales, les mégots, les graisses, et les épanchements d’urine. |
||||||||||
| Éléments
de méthode et de cartographie |
||||||||||||
|
Méthodologie •
La propreté et la sollicitation de l’espace public
cartographie la densité des points singuliers liés
à la propreté de l’espace public - souillures
animales, mégots, graisses, épanchements d’urine
- identifié par les équipes de nettoiement et signalé
via l’application mobile Dans ma rue. Ces densités
sont mises en relation avec les BL conservées ou non -
buffer de 15 m - et la répartition des BRT : disponibles,
indisponibles… |
||||||||||||
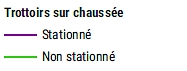 |
Les
trottoirs soumis au coulage de caniveau : Sources : Apur, DPE, DEVE, Eau de Paris |
|||||||||||
|
Méthodologie cartographique Cette carte de densité - carreau de 100 m x 100 m - est construite à partir des 15 067 points de restauration issus de l’enquête BDcom de l’Apur. Sources : Apur, DPE, DEVE, Eau de Paris |
||||||||||||
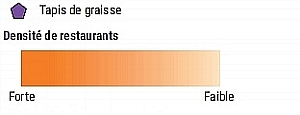 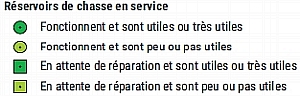 |
||||||||||||
|
Lecture cartographique Avec
une moyenne de 5 250 signalements, la rive droite de la Seine
- Paris Centre, Xe, XVIIe, XVIIIe, XIXe et XXe arrondissements
- apparaît comme le territoire le plus soumis aux souillures
pour lesquelles l’eau non potable joue un rôle primordial. |
||||||||||||
|
||||||||||||