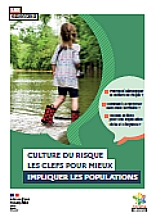....
. ![]() Anticiper
le risque inondation
Anticiper
le risque inondation
....
De
nouvelles solutions pour adapter les territoires
au changement climatique
.
(1)
Réhabiliter la place de l’eau sur le territoire
Mieux
intégrer les aléas climatiques récents dans la
gestion de innondations
Des
actions de prévention adaptées à l'urgence climatique
sur le terrain
...
L'intensification de phénomènes d'inondation et l'accroissement
de leur fréquence nécessite de penser, sur le temps long,
l'aménagement
avec l'eau et non uniquement contre l'eau. La trajectoire
climatique désormais de référence pour la France
- +4°C en 2100 - incite d'autant plus
à améliorer les stratégies territoriales mises en
œuvre pour prévenir les inondations, et tirer au plus vite
les enseignements des épisodes exceptionnels récents. Le
Cerema accompagne les collectivités pour réhabiliter
la place de l'eau sur leur territoire,
et dans l'ensemble de leurs projets d'aménagement.
| Réhabiliter la place de l’eau sur le territoire | |||||||||||||||
| Les
inondations qui ont frappé les Hauts-de-France à
la fin de l’année 2023 sont cette année suivi
d'épisodes historiques comme dans la vallée d'Aspe
(7 septembre 2024) ou dans les départements de l'Ardèche,
du Rhône et de la Haute-Loire (18 octobre 2024). Accroître
la résilience des territoires aux inondations, diminuer
le coût des dommages et massifier les actions nécessaires
sont désormais indispensables. Coupler la prise en compte
des conséquences du changement climatiques et les options
d'aménagement pour tous les territoires urbains, ruraux,
de montagne ou du littoral, faire évoluer nos pratiques
d'aménagement sont désormais des axes vitaux.
|
|
||||||||||||||
| Un
changement de paradigme : on ne cherche plus à lutter contre mais à vivre avec l’eau. |
|||||||||||||||
| .... |
|||||||||||||||
|
|
Inondations : mieux les connaître pour mieux agir L’enjeu de protection contre les inondations Le
changement climatique accroît l’intensité de
certains phénomènes météorologiques
et augmente leur fréquence. Ces évolutions, couplées
à l’imperméabilisation des sols, aux changements
de pratiques agricoles favorisant le ruissellement et à
la densification des enjeux dans les zones aménagées,
aggravent les risques liés aux inondations. La politique nationle de prévention des risques : Les 7 piliers de la prévention Des facteurs aggravants :
|
||||||||||||||
|
Le rôle du Cerema dans la prévention et la gestion du risque inondation auprès des territoires
Expertise dans les Alpes Maritimes après le passage de la tempête Alex - 2020 © Cerema |
||||||||||||||
| Des experts sur le terrain en réaction aux intempéries de l'automne 2024 Dans
l'urgence, juste après le travail des secours, le Cerema
est mobilisé sur le terrain pour réaliser des expertises
et identifier les infrastructures impactées : ponts, routes… |
|||||||||||||||
| .... Des actions de prévention adaptées à l'urgence climatique sur le terrain |
|||||||||||||||
| Sensibiliser les populations à la culture du risque La
culture du risque constitue l’ensemble des actions pour
améliorer la connaissance et la perception du risque par
les populations, et ainsi favoriser l'adoption des bons comportements
en cas d'événement majeur et de crise. |
Les clés de la réussite S’appuyant
sur des entretiens menés avec des porteurs d’actions
de culture du risque en France, ces 12 clés de réussite
aident les élus et acteurs du territoire à adopter
de bonnes pratiques, à organiser leur travail, et planifier
le déploiement de leurs propres actions pour développer
la culture du risque sur leur territoire. Chaque clé peut
être utilisée indépendamment, ou combinée
à d'autres, en fonction des caractéristiques et
besoins locaux. |
||||||||||||||
| Les cahiers Culture du risque - Les populations au cœur de l’action Réalisé à partir de l’expérience des auteurs, et de plusieurs entretiens auprès d’acteurs portant des initiatives choisies parmi un panel d’actions reflétant les différents leviers pour la culture du risque, ce document propose des clés pour réussir une démarche d’implication et de sensibilisation des populations aux risques. cerema.fr |
|||||||||||||||
Mieux aménager les territoires en mutation exposés aux risques naturels Le
Cerema était partenaire du concours d’idées
national Mieux aménager les territoires en mutation
exposés aux risques naturels, organisé par
le Plan Urbanisme Construction Architecture), en collaboration
avec la Direction Générale de la Prévention
des Risques du ministère de la Transition écologique,
de l’Énergie, du Climat et de la Prévention
des risques. Animation
sur les risques en montagne auprès de collégiens Afin d’adapter les villes aux inondations, 5 éléments apparaissent ainsi nécessaires à la conciliation de la réduction de vulnérabilité et de la qualité d’usage urbain :
Gestion
des inondations aux Andelys (Eure) |
Les
essentiels 10
pages pour informer les élus locaux sur l'essentiel : |
||||||||||||||

 |
|||||||||||||||
| Évaluer
systématiquement les vulnérabilités aux
inondations dans AgiRisk Diagnostiquer rapidement la vulnérabilité d’un territoire aux inondations Le
Cerema a finalisé en 2023 la démarche et une première
version de l'outil AgiRisk - Amélioration de la gestion
individualisée de la résilience aux inondations
des systèmes territoriaux -, pour aider les acteurs des
territoires à réaliser un premier diagnostic de
vulnérabilité aux inondations, et à mettre
en place, suivre et évaluer des actions pertinentes de
réduction de cette vulnérabilité. Mettre en place une stratégie de prévention des inondations grâce à la compétence GEMAPI L’attribution de la compétence Gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations - GEMAPI au bloc communal clarifie les responsabilités et fournit les outils juridiques et financiers nécessaires pour leur exercice. Le volet prévention des inondations de la GEMAPI s'appuie en particulier sur des actions de type : aménagement de bassins versants, protection contre les inondations, venant de la mer ou des crues… Dans ce cadre, le Cerema propose une offre intégrée d’accompagnement des territoires, s’appuyant sur la cartographie des zones inondables, et l’identification des enjeux critiques, sur l’évaluation de la performance des systèmes de protection contre les inondations, sur la gestion des milieux aquatiques et la prévention des inondations. L’accompagnement
de 15 collectivités pour exercer la GEMAPI dans le cadre
d’une gestion globale de l’eau Capitaliser
les enseignements pour l'ensemble des collectivités
Il vise également la valorisation d’expériences innovantes, et la mise en réseau d’acteurs ayant des problématiques identiques. |
|
||||||||||||||
|
Renforcer la résilience du territoire face aux inondations L’exemple de Verdun Le
Cerema a réalisé dans le département de la
Meuse - Grand Est - une étude de recensement des enjeux
et de leur vulnérabilité aux inondations sur le
territoire à risques importants d’inondation (TRI)
de Verdun, en cartographiant les zones les plus sensibles en matière
de sécurité des populations, et en proposant des
mesures adaptées pour réduire les risques, diminuer
le coût des dommages, et faciliter un retour rapide à
une situation normale. Canal des Augustins - Verdun © Cerema |
 |
||||||||||||||
Projet REAUZOH Localiser et suivre les zones potentiellement humides Dans le cadre de sa compétence Gemapi, la Communauté d’Agglomération Béthune-Bruay, Artois Lys Romane (CABBALR) s’est associée au Cerema pour mener un programme de recherche et développement sur le Recensement, la cArtographie et le sUivi de l’évolution des Zones pOtentiellement Humides : REAUZOH. Ce
projet vise à réaliser, pour la première
fois, une étude sur le territoire de la CABBALR, grâce
à une méthodologie innovante développée
par le Cerema, basée sur des images satellitaires traitées
par intelligence artificielle (IA).
L’objectif du projet est de pouvoir suivre la dynamique des espaces potentiellement humides et de la couverture végétale, à partir de cartographies annuelles de 2018 à 2023, pour connaître l’impact de la régression de la végétation sur les espaces humides. |
|||||||||||||||
 |
|||||||||||||||
|
|||||||||||||||