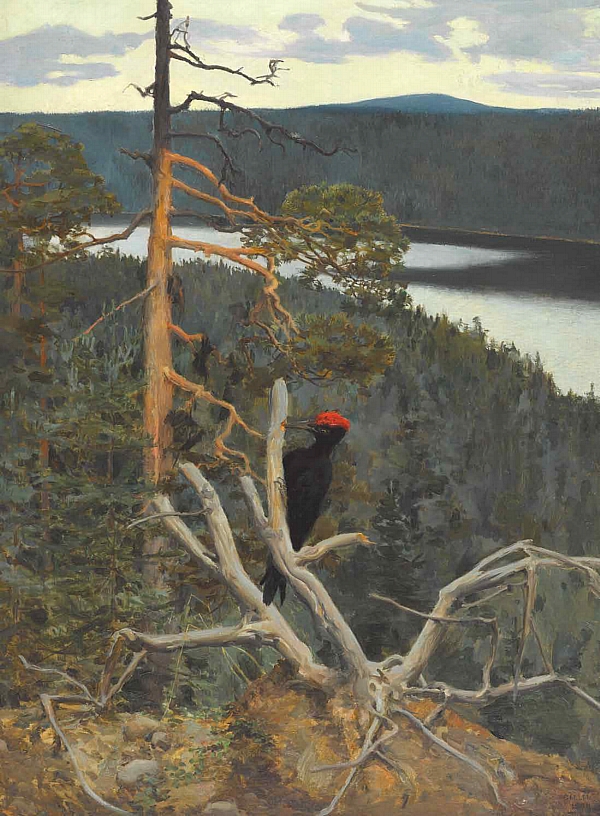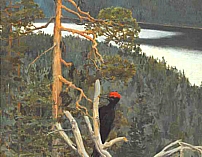|
Miroir des évolutions de nos sociétés, l’art
est un espace privilégié pour interroger le monde qui nous
entoure. Avec 100 œuvres qui racontent
le climat, le musée d’Orsay lance un programme de prêt
d’œuvres qui témoignent dans la peinture, la photographie,
le dessin ou les arts décoratifs de l’influence des grandes
mutations du XIXème siècle sur le climat, en profonde résonance
avec les défis environnementaux d’aujourd’hui. En parcourant
ces œuvres, nous découvrons les métamorphoses de nos
paysages, les inquiétudes face au progrès,
les nouveaux rapports à la nature et au vivant apparus avec l’ère
industrielle. Les œuvres prêtées sont une invitation
à la réflexion
et à l’action. En mettant en lumière les fragilités
de nos territoires et la richesse de notre patrimoine naturel et artistique,
elles nous rappellent que la culture est au cœur des enjeux de demain.
Rachida Dati, Ministre de la Culture
| Introduction
: une démarche exemplaire |
|
| Le
musée d’Orsay s’est toujours attaché
à être bien plus qu’un lieu de conservation
: il est un pont vivant entre les œuvres et les territoires
qui les ont inspirées.
Avec
100 œuvres qui racontent le climat, nos collections
deviennent le support d’une réflexion universelle
et d’un travail collaboratif avec des musées partenaires
à travers toute la France, autour d’un thème
qui nous concerne tous, individus comme organisations, le bouleversement
climatique.
Ce projet repose sur une conviction forte : les musées
sont des acteurs essentiels pour rapprocher les publics des grands
enjeux contemporains. Il s’articule ainsi autour d’un
double engagement : faire dialoguer art et science pour éclairer
les enjeux écologiques, et inscrire ces échanges
au plus près des territoires. Chaque musée participant
devient ainsi un acteur essentiel de ce dialogue, un lieu de réflexion
collective, ancré dans son contexte local.
Les cent œuvres sélectionnées, issues de domaines
variés de nos collections, et choisies pour leur capacité
à dialoguer avec les savoirs scientifiques, témoignent
des bouleversements initiés au XIXème siècle,
en pleine industrialisation. À travers des représentations
de la faune, de la flore, des paysages ou encore des scènes
de la vie moderne, elles racontent les origines des défis
climatiques que nous affrontons aujourd’hui. Ces créations
ne se contentent pas de représenter le monde : elles l’interrogent,
et nous interrogent avec lui. Dans cette dynamique, il nous paraît
essentiel d’inscrire ce projet dans une démarche
exemplaire sur le plan environnemental. Concilier ambition culturelle
et responsabilité écologique est un défi
que nous relevons avec conviction. Le musée d’Orsay
s’engage ainsi à limiter l’empreinte carbone
de cette initiative, en privilégiant des matériaux
biosourcés et réutilisables pour l’emballage
des œuvres, en optimisant les tournées de transport
grâce à des groupages régionaux, et en favorisant
l’usage de biocarburants lorsque cela est possible. Chaque
musée partenaire s’inscrit dans cette même
exigence, afin que la circulation de ces œuvres, porteuses
d’une réflexion sur les enjeux climatiques, soit
en cohérence avec le message qu’elles véhiculent.
Plus qu’une réflexion, ce projet est ainsi une invitation
à agir. En tissant des liens entre arts, sciences et territoires,
les 100 oeuvres qui racontent le climat encouragent à
penser l’avenir avec lucidité, mais aussi avec espoir,
en trouvant dans le patrimoine une source d’inspiration
et d’engagement. Je tiens à remercier chaleureusement
toutes les institutions qui s’associent à cette aventure
en proposant des projets scientifiques passionnants, ainsi que
les équipes du musée d’Orsay, qui ont relevé
le défi d’organiser ce premier opus en un temps record.
Ensemble, en valorisant nos territoires et leur histoire, nous
pouvons contribuer à la construction d’un avenir
durable, qui préservera à la fois notre environnement
et notre patrimoine commun. Sylvain Amic,
Président de l’Établissement public du musée
d’Orsay
Akseli
Gallen Kallela, Palokärki ; le Grand Pic noir, 1894, huile
sur toile marouflée sur carton, 146 × 91 cm. Achat
avec le soutien de la famille de Akseli Gallen-Kallela, 2020
© Musée d’Orsay, dist. GrandPalaisRmn
/ Patrice Schmidt
|
|
|
| Présentation
: Une opération nationale |
|
| Des
prêts exceptionnels
Le
musée d’Orsay a sélectionné 100 chefs-d’œuvre
de sa collection qui racontent le climat et invite, de
mars à juillet, les musées de toutes les régions
à accueillir une ou plusieurs de ses œuvres. Sculpture,
arts graphiques, peinture, photographie, dessins d’architecture
et arts décoratifs… Ces 100 œuvres emblématiques
racontent l’histoire du climat depuis le milieu du XIXème
siècle. Parmi elles, 49 seront présentées
dans 31 institutions réparties sur 12 régions de
France, à travers des expositions thématiques, des
visites, des conférences et des ateliers ouverts à
tous les publics.
Anna
Boch, Cueillette, 1890, huile sur toile, 74 x 107 cm, Paris, musée
d'Orsay
© photo : musée d’Orsay, dist.
GrandPalaisRmn / Sophie Crépy
Un
parcours au musée d'Orsay
Les
autres œuvres seront exposées au sein d’un parcours
thématique avec des cartels spécifiques dans les
collections permanentes du musée d’Orsay. |

|
|
Un
livre
Parallèlement,
le musée d’Orsay publie le livre 100 œuvres
qui racontent le climat. Il réunit des experts mondiaux
du climat et des conservatrices du musée d'Orsay pour mener
une analyse du dérèglement climatique à travers
les œuvres des collections du musée.
L’Établissement poursuivra cet engagement chaque
année, en mettant en lumière un grand sujet contemporain
par le partage d’œuvres issues de ses collections à
travers toute la France.
|
|
| |
Ces
réflexions font émerger une vision à la fois
critique et optimiste du rôle des musées dans un
monde en transition, non seulement comme lieux de conservation
du patrimoine, mais aussi comme acteurs de changement.
|
|
Le
danger que représente le dérèglement climatique
pour le patrimoine est très concret : événements
météorologiques extrêmes, élévation
du niveau des mers, chute de la biodiversité, raréfaction
de l’eau potable, vastes régions du monde devenant
invivables… Que deviendront les œuvres d’art
dans un tel futur ?
Le musée sera-t-il encore capable de remplir sa mission
première de conservation dans un environnement hostile
?
Rien n’est moins sûr, car le changement climatique
amplifie d’ores et déjà l’extrême
vulnérabilité des œuvres.
Face à cette nouvelle donne, le musée se doit
de contribuer à la création d’un avenir
viable, qui seul permettra la conservation des œuvres de
l’humanité et leur transmission intacte aux générations
futures. Pour y parvenir, le musée d’Orsay met
en œuvre des actions concrètes depuis 2019, visant
à réduire son empreinte carbone, à repenser
la durabilité de ses activités avec l’écoconception
des expositions, le transport responsable des œuvres et
la réduction de la consommation d’énergie.
Mais l’Établissement entend aussi agir sur le terrain
des idées. Malgré le consensus scientifique sur
le dérèglement climatique et son origine anthropique,
une large part de la population se tient encore à distance
de ces réalités, freinée par le déni,
la peur ou l’ignorance, qui paralysent l’action.
Les scientifiques eux-mêmes le reconnaissent : la bataille
pour le climat est désormais culturelle. Si les chiffres
peinent à mobiliser, l’art, la littérature
et le cinéma peuvent susciter des émotions, façonner
des récits pour transformer les consciences.
Dans
le cadre de cette opération nationale, nous avons, avec
Élise Dubreuil, conservatrice Arts décoratifs
et Marie Robert, conservatrice en chef Photographie et Cinéma
au musée d’Orsay, engagé un dialogue stimulant
avec quatre experts du climat et de la biodiversité :
Jean Jouzel, paléoclimatologue et ancien vice-président
du GIEC, Valérie Masson-Delmotte, paléoclimatologue,
directrice de recherche au CEA, Luc Abbadie, écologue
et ancien directeur de l’Institut de la Transition écologique,
et Emma Haziza, hydrologue spécialisée dans l’adaptation
au changement climatique.
Leurs analyses révèlent que les problèmes
actuels liés au réchauffement climatique trouvent
précisément leur source dans la période
couverte par les collections du musée d’Orsay,
de 1848 à 1914. Cette époque, aux bouleversements
profonds liés à la révolution industrielle,
marque le début de l’Anthropocène, une nouvelle
ère géologique définie par l’impact
déterminant des activités humaines sur la planète.
C’est pourquoi cette période est désormais
utilisée comme référence pour mesurer le
réchauffement climatique : l’évolution de
la température moyenne annuelle mondiale est mesurée
en fonction de l’écart par rapport à la
moyenne des températures enregistrées entre 1850
et 1900.
De nombreux artistes représentés dans les collections
d’Orsay - peintres de Barbizon, réalistes, naturalistes,
impressionnistes - ont en commun de s’être attachés
à saisir la réalité du monde, faisant des
œuvres de véritables fenêtres sur cette époque.
Jusqu’au milieu du XIXème siècle, elles
reflètent encore une certaine harmonie entre l’homme
et son environnement. Mais, sous l’effet de l’industrialisation,
les paysages changent progressivement. Locomotives fumantes,
ponts métalliques, cheminées d’usines et
vapeurs font leur apparition, premiers marqueurs visuels d’un
monde qui s’engage vers une dépendance croissante
aux énergies fossiles, en abandonnant progressivement
les énergies naturelles : vent, eau, traction animale.
Les collections du musée d’Orsay racontent aussi
l’exploitation accrue des ressources naturelles pour soutenir
la croissance économique et l’expansion phénoménale
des villes.
Ces œuvres d’art, tout en illustrant les changements
causés par l’industrialisation, soulignent également
la fragilité de la biodiversité et des paysages
qui ont inspiré les artistes du XIXème et du début
du XXème siècle. Parmi les œuvres présentées,
l’ours blanc sculpté par François Pompon
incarne à lui seul les défis environnementaux.
Cette figure emblématique ne doit toutefois pas faire
oublier la multitude d’autres espèces, souvent
invisibles mais essentielles à l’équilibre
de notre écosystème : les pollinisateurs, les
vers de terre, ou encore les poissons, comme la truite de la
Loue, peinte par Gustave Courbet en 1873, aujourd’hui
menacée. Les paysages sauvegardés en peinture
et en photographie - tels que le lac de Van en Turquie, un verger
en Normandie, ou encore la mer de Glace des Alpes - risquent
de disparaître dans la réalité, à
cause de facteurs variés que le dérèglement
climatique vient aggraver.
Cependant, au-delà des constats alarmants, les experts
rappellent l’importance de nourrir les générations
futures avec espoir et gratitude envers ce qui nous entoure.
Dans cette perspective, les œuvres d’art peuvent
aussi devenir des guides précieux. En nous invitant à
observer le passé pour mieux comprendre les défis
actuels, elles ouvrent la voie à une réflexion
sur un avenir à faible émission de carbone. Ces
réflexions font émerger une vision à la
fois critique et optimiste du rôle des musées dans
un monde en transition, non seulement comme lieux de conservation
du patrimoine, mais aussi comme acteurs de changement.
Servane Dargnies-de Vitry, Commissaire, conservatrice en chef
Peinture, musée d'Orsay
Armand
Guillaumin, Paysage en Normandie : Les pommiers, vers 1887,
huile sur toile.
60,5 x 100,0 cm. Collection Musée d'Orsay. Legs Antonin
Personnaz, 1937
© photo : GrandPalaisRmn (musée d’Orsay)
/ Hervé Lewandowsk
|
|
| Un
ouvrage de référence pour explorer les grands enjeux
écologiques
de notre époque
Le
livre 100 oeuvres qui racontent le climat réunit
les analyses d’experts de renom qui offrent un regard inédit
sur les collections du musée, en soulignant la manière
dont ces œuvres résonnent avec les enjeux actuels
du changement climatique. Sous la direction de :
Servane Dargnies-de Vitry, conservatrice en chef Peinture au musée
d’Orsay.
Coédition musée d’Orsay / GrandPalaisRmn -
Parution le 26 mars 2025
Format : 16,5 × 24 cm - 224 pages – 35 € |
|
| 
|
La
bataille pour le climat est désormais culturelle. Si les
chiffres peinent à mobiliser, l’art, la littérature
et le cinéma peuvent susciter des émotions, façonner
des récits pour transformer les consciences. |
|
Gustave
Marchegay, Truite, vers 1928, statuette en bronze, 12 x 13,5 x 7,5
cm. Collection musée d'Orsay. Don Mme G. Marchegay, 1932
© GrandPalaisRmn (musée d’Orsay)
/ Hervé Lewandowski |
|
 |
|
Liste
des œuvres prêtées
49 œuvres prêtées - 31 institutions participantes
- 12 régions représentées
|
| AUTUN
Odilon Redon, Marguerites
AVIGNON
Édouard Baldus, Inondations du Rhône
en 1856, à Avignon
BARBIZON
• Théodore Rousseau, Clairière dans
la Haute Futaie, forêt de Fontainebleau
• Charles François Daubigny, Moisson
• Constant Alexandre Famin, Paysan
fauchant
• Constant Alexandre Famin,
Jeune paysanne faisant les foins
BLOIS
Edouard Manet, Le Citron
BREST
Alexandre Sergejewitsch Borisoff,
Les Glaciers, mer de Kara
CHERBOURG-EN-COTENTIN
Akseli Gallen Kallela, Palokärki ;
le Grand Pic noir
COGNAC
• Eugène Fromentin, Le Pays de la soif
• Gustave Guillaumet, Le Sahara
CONCHES-EN-OUCHE
Eugène Rousseau, Vase
|
DIGNE-LES-BAINS
• Claude Monet, La Gare Saint Lazare
• Albert Edelfelt, Journée de décembre
DIJON
• Jean Charles Cazin, Les Quais
• Henri Rivière, Du Point du Jour
• Henri Rivière, Sur les toits
• Robert Demachy, Neige
• Fernand Arnal, Port d’Orsay,
6 mars 1906
• Fernand Arnal, Crue de la Seine,
port d’Orsay, 9 mars 1906
• Édouard Baldus, Inondations du Rhône
en 1856, à Lyon
• Félix Thiollier, La Cokerie Verpilleux, environs
de Saint Etienne
GRENOBLE
Gustave Caillebotte, Les Soleils,
jardin du Petit Gennevilliers
LA ROCHE-SUR-YON
• Alfred Stieglitz, Equivalent
• Alfred Stieglitz, Equivalent
• Alfred Stieglitz, Equivalent
• Alfred Stieglitz, Equivalent
LAVAL
Henri Rousseau, La Charmeuse
de serpents |
LE CANNET
Pierre Bonnard, La Symphonie pastorale
LE
PUY-EN-VELAY
Eugène Delacroix, Chasse au tigre
LIBOURNE
Lionel Walden, Les Docks de Cardiff
LUNEL
Claude Monet, Le Jardin de l’artiste
à Giverny
MACON
Anna Boberg, Printemps arctique
MONTARGIS
Alfred Sisley, L’Inondation à Port Marly
MONTAUBAN
Claude Monet, Londres, le Parlement.
Trouée de soleil dans le brouillard
ORNANS
Gustave Courbet, La Truite
PONT-AVEN
Paul Signac, Route de Gennevilliers
SAINT-CYR-SUR-MORIN
Claude Monet, Les Déchargeurs
de charbon |
SAINT-JEAN-D’ANGELY
Charles Emile de Tournemine, Eléphants d’Afrique
SAINT-QUENTIN
Camille Pissarro, La Seine à Port Marly, le lavoir
SOISSONS
Edouard Manet, Anguille et rouget
STRASBOURG
• Charles Jean Avisseau, Coupe
• Charles Jean Avisseau, Bassin
TOURS
Alfred Sisley, Temps de neige à Veneux Nadon
TULLE
Antoine Bourdelle, Le Bélier rétif
VERNON
Claude Monet, Les Glaçons
VULAINES-SUR-SEINE
• Odilon Redon, Vase de fleurs : le pavot rouge
• Georges Seurat, Etude pour
« Une baignade à Asnières »
• Edouard Manet, Branche de pivoines
blanches et sécateur |
|
.....
 .Exposition
100 œuvres qui racontent le climat .Exposition
100 œuvres qui racontent le climat
...
La culture fédère
et rassemble, pour mieux réinventer nos regards
sur le monde. Avec cette initiative, une grande institution
parisienne permet à des musées de région
de profiter de l’incroyable richesse de sa collection
: ce sont ainsi 49 œuvres majeures qui voyagent
à travers la France vers plus de 30 établissements
partenaires, pour aller à la rencontre des
publics bien au-delà des grands centres urbains.
Rachida Dati, Ministre de la Culture
|
|
| |
....
Au
musée d’Orsay et en région, 100
œuvres emblématiques racontent l’histoire
du changement climatique depuis le milieu
du XIXème siècle. Avec
cette opération, le musée vous invite
à prendre pour guide les peintres, sculpteurs
et photographes,
mais aussi les naturalistes, pour redécouvrir
ses chefs-d’œuvre avec un nouvel éclairage.
Les artistes ont été les témoins
des transformations, révélant la modernisation
du monde, son urbanisation rapide, tout comme la richesse
de ses paysages, de la faune et de la flore, dont on
perçoit aujourd’hui toute la fragilité.
Au fil des salles, comme dans plus d’une trentaine
de musées répartis en France métropolitaine,
à vous de déceler les premiers indices
d’une bifurcation écologique et climatique,
dont les effets sur notre environnement sont désormais
perceptibles sans ambiguïté.
Servane
Dargnies-de Vitry, commissaire du projet, conservatrice
en chef Peinture, souligne le rôle que les musées
peuvent jouer dans la sensibilisation aux
enjeux environnementaux, et rappelle l'engagement historique
des artistes pour la protection de la nature,
notamment celui des paysagistes du XIXème siècle.
musee-orsay.fr
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() Exposition
100 œuvres qui racontent le climat
Exposition
100 œuvres qui racontent le climat