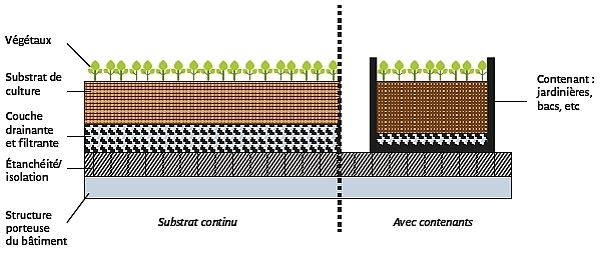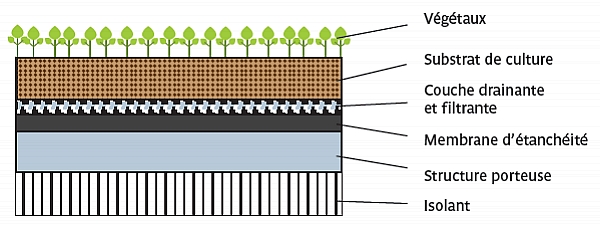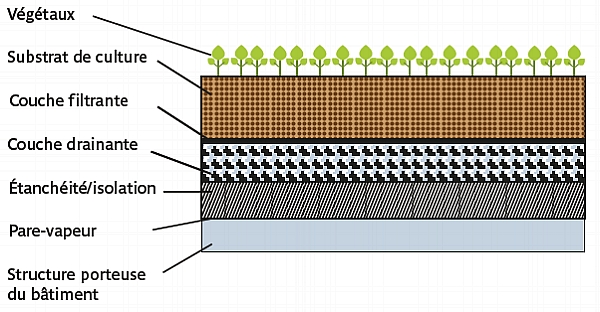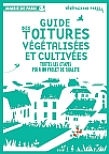![]() Guide
des toitures végétalisées
et cultivées
Guide
des toitures végétalisées
et cultivées
Toutes les étapes pour un projet de qualité
(3)
Le
bâtiment, support du projet de végétalisation
Différentes
formes de toitures, végétalisation ou culture
De nombreuses études soulignent les bienfaits de la végétalisation
du bâti en ville. S’ils sont souvent difficiles à quantifier,
ces bienfaits se concrétisent à différentes échelles
- du bâtiment lui-même, du quartier, de la ville… -
et dans différents domaines : gestion de l’eau, énergie,
cadre de vie, social, biodiversité… Les toitures peuvent
afficher de multiples facettes, selon les bénéfices recherchés
par le créateur du projet. Cette multifonctionnalité en
fait un véritable atout pour l’aménagement urbain.
Dans ce document, conçu par la Ville de Paris, la toiture végétalisée
désigne un toit - élément porteur et complexe isolation-étanchéité
- sur lequel est apposé un complexe de végétalisation*
: composé éventuellement d’une couche drainante* et
d’une couche filtrante*, du substrat de culture et de la végétation
qui s’y développe, en contenants ou non. Une toiture dispose
d’un accès plus ou moins contraignant - échelle, escaliers…
- , par l’extérieur ou l’intérieur du bâtiment,
d’un dispositif de sécurité - garde-corps, ligne de
vie -, de chemins de circulation et éventuellement de zones sans
végétation appelée bandes stériles.
* voir Lexique en bas de page
| Le bâtiment, support du projet de végétalisation | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Accès et aménagement Les accès sont essentiels à prendre en compte dès la mise en place du projet
Différentes solutions sont possibles pour permettre un accès adapté à la végétation mise en place, en toute sécurité. Les
accès aux toitures doivent être sécurisés
pour les personnes chargées de leur entretien et pour
l’acheminement des outils nécessaires à
cet entretien. Ils peuvent être multiples : accès
prévu initialement par escalier ou ascenseur, accès
par échelle dite à crinoline* - avec
protection antichute -, intérieure ou extérieure,
accès par échelle inclinée et skydôme
ou puits de lumière. Parfois, certaines terrasses ne
disposent pas d’accès à proprement parler
: accès via une fenêtre, accès uniquement
en apposant une échelle sur le mur par l’extérieur. Accès
au toit du centre sportif Jean-Dame (IIe) par une échelle
à crinoline Circulation sur la toiture Toutes
les circulations doivent être sécurisées,
sans obstacle à enjamber, et garantir la sécurité
du travailleur - selon le Code du travail - ou du public présent,
selon la Réglementation ERP. La zone stérile permet :
Cependant,
l’aménagement de la toiture peut conduire à
réduire ou supprimer ces zones stériles. Il faut
alors veiller à maintenir un accès facile aux
relevés d’étanchéité et mettre
en place un aménagement qui ne nécessite pas un
entretien pouvant endommager l’étanchéité.
Il est recommandé de faire appel à un bureau de
contrôle pour vérifier la conformité de
l’installation. Protection contre les chutes La
composition du substrat - granulométrie*, éléments
liants - et sa stabilité sont à étudier
pour limiter les risques de glissement et d’érosion.
Un bon enracinement est important pour garantir le maintien
du complexe de végétalisation : fixation et stabilisation
du substrat. Le choix des végétaux devra particulièrement
tenir compte des capacités de rétention d’eau
- écoulement vers le bas - et de l’exposition du
toit : ensoleillée ou ombragée. Zone
stérile gravillonnée en pourtour du toit de l’atelier
Radiguet (XIXe) Points d’eau et évacuation Il est indispensable de prévoir un - ou plusieurs - points d’eau, de débit bien dimensionné à la surface végétalisée ou cultivée et ce même pour une toiture prévue pour un faible entretien. Les Règles Professionnelles recommandent que tout point de la toiture soit situé à moins de 30 mètres d’un point d’eau. Un système d’arrosage automatique peut être intégré, il est alors conseillé de prévoir une alimentation électrique (230V, 10A). Le point d’eau, à défaut d’être en toiture, est parfois disponible à proximité, à l’étage en dessous par exemple. L’eau est alors amenée en toiture via un dérouleur pour tuyau d’arrosage. En cas d’arrivée d’eau directement sur le toit, il faudra prévoir une purge de l’installation en hiver. Les dispositifs d’évacuation des eaux pluviales - entrées des eaux pluviales et trop-pleins - doivent être présents et en bon état de fonctionnement. Chaque toiture doit comporter au moins deux descentes ou une descente et un trop-plein. Les évacuations doivent être équipées d’un système permettant de retenir les débris - feuilles, papiers… - pour éviter tout engorgement des descentes : crapaudines, garde-grèves… Ils doivent être vérifiés au minimum une fois par an. Chantier
d’aménagement du toit végétalisé
du bâtiment annexe de l’Hôtel de Ville, |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Différentes formes de toitures et végétalisation ou culture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| On parle :
Ce type de toiture, plus rare, est également compatible avec la végétalisation, mais uniquement sur structure béton, avec une pente comprise entre 0 et 5%. Il peut nécessiter la mise en place d’une couche de séparation entre l’isolant et le complexe de culture.
|
Ce cas est courant pour les bâtiments anciens - avant 1975 -, n’ayant pas encore fait l’objet de rénovation thermique avec isolation par l’extérieur. Il n’est pas aujourd’hui recommandé car il pose des problèmes d’accumulation de vapeur d’eau qui ne peut être évacuée à l’extérieur.
Ce
cas est le plus fréquent, il faut s’assurer que l’isolant
soit compatible avec la végétalisation : classe
de compressibilité. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LEXIQUE |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| complexe
de végétalisation
:
ensemble composé de la couche drainante, la couche filtrante,
le substrat et la végétation couche drainante : couche poreuse, permeant l’évacuation des excès d’eau couche filtrante : couche retenant les particules qui pourraient colmater la couche drainante |
crinoline : échelle entourée d’arceaux
circulaires métalliques qui protègent l’utilisateur
des chutes granulométrie : taille des différents grains composant le substrat |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||