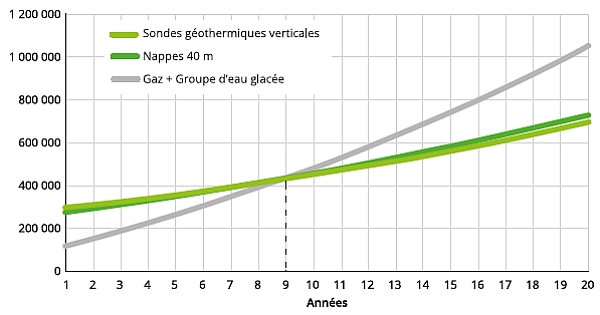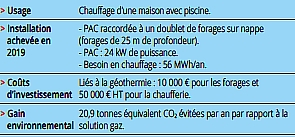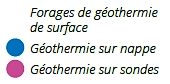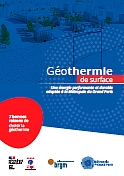![]() La
géothermie, un enjeu énergétique crucial
La
géothermie, un enjeu énergétique crucial
(2)
Géothermie de surface : une énergie performante
et durable adaptée à la Métropole du Grand Paris
Introduction
- 7 bonnes raisons de la choisir :
1.
Une facture énergétique maîtrisée - 2. L’exemplarité
environnementale
3. La promotion des ressources locales (…)
La Métropole du Grand Paris travaille depuis début 2020
à une déclinaison très opérationnelle de la
trajectoire de transition énergétique
du Plan Climat national, à travers l’élaboration du
Schéma Directeur Energétique Métropolitain. Le développement
d’une filière telle que la géothermie de surface s’inscrit
pleinement dans les objectifs de transition énergétique
ainsi poursuivis : il s’agit d’une énergie décarbonée,
locale, pertinente économiquement et parfaitement adaptée
aux spécificités de notre territoire. En partenariat avec
l’ADEME et le BRGM,
la Métropole du Grand Paris a souhaité développer
des outils visant à mettre en valeur cette solution parfois mal
appréhendée.
Patrick
Ollier, Président de la Métropole du Grand Paris
| Introduction | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sur
le plan énergétique, les territoires sont confrontés
à un défi majeur : maîtriser et planifier
les besoins en énergie de leur population, en réduisant
les émissions de CO2, à un coût raisonnable.
À quelques mètres sous nos pieds, se trouve un
élément de solution : la géothermie ! 1. Une facture énergétique maîtrisée La géothermie : une énergie compétitive Ses coûts d’exploitation réduits permettent à la géothermie de surface d’être une énergie compétitive dans le temps. En moyenne, le temps de retour sur investissement de ces installations par rapport à une solution au gaz est de 5 à 18 ans, et de 10 ans dans le tertiaire (1). Une fois l’investissement amorti, il ne reste qu’à s’acquitter des coûts d’exploitation réduits, et ce pendant plusieurs décennies : la durée de vie des forages est estimée à 50 ans (2), celle des pompes à chaleur, moins coûteuses que ces derniers, à 17 ans (3). Coûts cumulés de trois solutions pour le collectif combinant chauffage et rafraichissement © AFPG De
leurs côtés, les énergies fossiles, polluantes
et épuisables, seront toujours caractérisées
par un marché volatile et une probable augmentation de
leur taxation, par le biais de la contribution climat énergie,
par exemple.
|
Installation
Celsius sur le campus de Schlumberger Clamart (92) |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
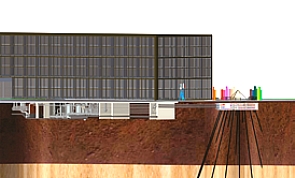 Schéma 3D du dispositif et de son intégration dans le bâtiment © Celsius Energy |
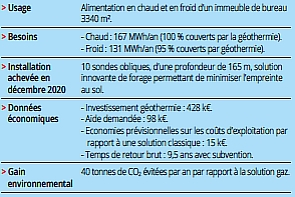 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palais
des Sports de la Ville de Puteaux (1)
Géothermie de surface, étude technico-économique,
Association Française des Professionnels de la Géothermie
(AFPG), 2020, selon les technologies. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ....... La stabilité des températures du sous-sol au cours des saisons permet de produire aussi bien du chaud que du froid. En
hiver, la chaleur prélevée dans le sol sert à
chauffer le bâtiment. En été, la fraîcheur
du sous-sol peut refroidir/rafraîchir les constructions.
Ces usages présentent l’avantage de recharger
thermiquement le sous-sol, et ainsi d’augmenter la performance
des installations pour la saison suivante.
La
température du sous-sol est suffisamment basse pour rafraîchir
directement et naturellement le bâtiment, un simple échangeur
de chaleur suffit alors à alimenter le circuit des émetteurs.
La pompe à chaleur n’étant pas sollicitée,
cela rend cette solution particulièrement économique. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ....... 2. L’exemplarité environnementale |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immeuble
Le Hive à Rueil-Malmaison (92) |
Une énergie verte On
considère que les installations de géothermie de
surface rejettent, en moyenne, moins de 45 g de CO2 par kWh de
chauffage, des émissions associées à la consommation
électrique de la pompe à chaleur (5). Disponible
localement, la géothermie de surface n’implique pas
de transport. En effet, elle est, par nature, consommée
directement là où elle est produite. Ce sont donc
autant d’émissions de CO2 et de particules fines
qui sont évitées. Cela en fait un véritable
atout pour la qualité de l’air des territoires. Un engagement pour lutter contre le changement climatique Aux
côtés des autres sources d’énergie renouvelable,
la géothermie de surface est essentielle à l’atteinte
des objectifs de la Loi de Transition Énergétique
pour la Croissance Verte. Le Plan Climat Air Énergie Métropolitain,
adopté fin 2018, fixe pour l’horizon 2030 de porter
à plus de 50% de la consommation énergétique
finale la part des énergies renouvelables et de récupération,
dont au moins 20 % produites localement. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résidence
particulière avec piscine, à Saint-Maur-des-Fossés
(94) |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 |
Vue de la résidence particulière chauffée par géothermie |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| .... 3. La promotion des ressources locales |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Une
énergie disponible en permanence sur presque tout le territoire Les ressources géothermiques proviennent soit des roches du sous-sol - exploitation sur sondes - soit des nappes d’eau souterraines : exploitation sur nappe. L’exploitation de ces deux types de ressource passe ainsi principalement par deux technologies :
On crée une circulation d’eau dans un (ou des) tube(s) qui passe(nt) dans ces forages. L’eau se réchauffe - ou se refroidit selon les cas - en descendant sous terre, puis la température est alors valorisée en surface par une pompe à chaleur. Des projets de plus en plus nombreux sur tout le territoire de la Métropole du Grand Paris Fin 2020, plus de 620 forages de géothermie sont recensés au sein de la Métropole du Grand Paris, pour environ 250 opérations. 375 de ces forages de géothermie ont été déclarés ces 5 dernières années, ce qui indique une nette augmentation depuis l’existence du régime de déclaration Géothermie de Minime Importance (2015) (6). La géologie francilienne est favorable à la géothermie de surface A
l’échelle de la Métropole du Grand Paris,
l’empilement des couches géologiques permet qu’il
y ait au moins une nappe productive à faible profondeur
(<100 m) partout. |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
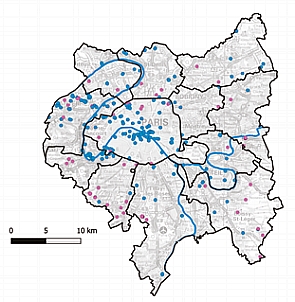 |
Alimentation
du quartier Pleyel |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cartographie
des opérations de géothermie |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Schéma
des terrains géologiques rencontrés sur le territoire
de la Métropole du Grand Paris en fonction de l’altitude.
Les principales nappes sont indiquées en bleu. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
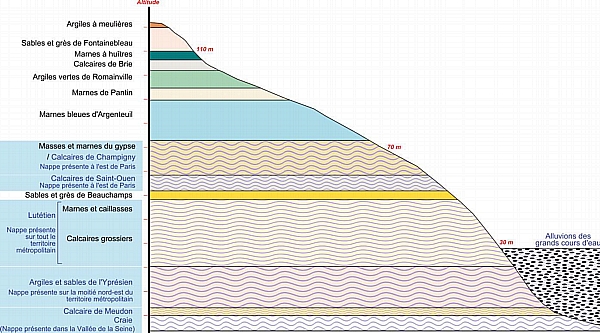 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ....... La
géothermie est une énergie locale. Elle n’implique
donc pas de transport, pas de gestion de stocks. En s’émancipant
des énergies fossiles, elle favorise l’indépendance
énergétique des territoires. Elle mobilise les talents
locaux : bureaux d’études, foreurs, installateurs…
et contribue à l’emploi de proximité. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||