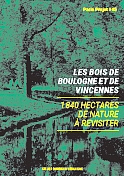|
Les
bois de Boulogne et de Vincennes sont deux espaces de respiration uniques,
situés au coeur du Grand Paris. Représentant à eux
deux près du quart de la surface du Paris urbanisé, les
deux bois occupent un espace équivalent aux huit premiers arrondissements.
Ils sont fréquentés par des habitués mais sont encore
méconnus par beaucoup d’habitants. Une grande diversité
d’usages existe : pour certains, ils représentent des axes
de circulation rapide, pour d’autres le plaisir du footing dans
les allées, de la promenade et pique-nique sous les arbres, du
canotage sur les plans d’eau… Les Charte du bois de Vincennes
(1) et de Boulogne, signées en 2003, ont constitué un cadre
précieux, en définissant quatre axes majeurs pour structurer
un projet ambitieux d’aménagement durable des bois : réhabiliter
les paysages et restaurer les milieux naturels ; réduire fortement
la circulation automobile pour une promenade tranquille ; reconquérir
l’espace public des bois et gérer les activités dans
la cohérence et la transparence ; et enfin innover dans les modes
de gestion et de gouvernance.
| Un
site chargé d’histoire : chasses royales, grands travaux
d’Alphand et plan de gestion d’un bois-forêt |
Le
bois de Vincennes, vestige de la forêt de Vilcena, l’antique
ceinture forestière de Lutèce, devient une réserve
de chasse royale au XIIe siècle, sous Phillipe Auguste,
qui le ceint de murs et l’approvisionne de gibier. Au
XVIIIe siècle, le bois fait plus de 750 ha quand Napoléon
1er le convertit en camp retranché de ses armées,
pour la protection de Paris. En résulte un vaste défrichement
qui coupe le bois en deux, en son milieu.
Au
XIXe siècle, lorsque Napoléon III confie à
Alphand l’embellissement du bois de Vincennes et de ses
extensions, le bois fait 995 hectares. Alphand aménage
les extensions du bois, dont le secteur Daumesnil, transforme
les pelouses en parcs à l’anglaise, trace des allées
courbes et fait creuser quatre lacs dans lesquels sont aménagées
des îles et quelques pavillons. Les emprises militaires,
toujours actives, sont réduites par la création
de l’hippodrome et les plantations le long de la route
de la Pyramide.
L’exposition coloniale de 1907 se tient dans l’une
des clairières aménagées par Alphand, l’actuel
Jardin d’Agronomie Tropicale. Cinq villages sont reconstitués
- Indochine, Madagascar, Congo, Soudan, Tunisie, Maroc - selon
les grandes possessions de l’empire français. En
1931, l’exposition coloniale internationale se tient près
de la porte Dorée, sur 110 hectares autour du lac Daumesnil.
Cette exposition a légué au bois le Palais de
la porte Dorée, classé monument historique, l’enclos
bouddhique comprenant l’ancien pavillon du Togo et l’ancien
pavillon du Cameroun, restauré en 1977 et transformé
en pagode, et le Parc zoologique inauguré en 1934, qui
fait suite au zoo temporaire aménagé lors de l’exposition
coloniale près de Saint-Mandé.
Après la seconde guerre mondiale, les emprises militaires
sont peu à peu rendues à la promenade et réaménagées
suivant les plans de Jean Trouvelot, architecte en chef du château
de Vincennes de 1942 à 1948, qui souhaitait relier le
bois au château et recréer la trame paysagère
des allées royales. Les plaines de jeux sont alors aménagées,
des routes sont créées à la place des anciens
champs de manœuvre, l’allée Royale est percée
en 1964, le Parc Floral réalisé en 1969.
À partir de 1977, la reconquête des bois se traduit
par la fermeture de voies à la circulation et la mise
en œuvre de plantations forestières, notamment dans
le secteur de l’allée Royale, pour reconstituer
le cœur de massif.
Fin 1999, les dégâts occasionnés par la
tempête Lothar ont détruit 20 % du bois (210 ha),
bouleversant profondément la cohérence des ensembles
forestiers et la perception des continuités paysagères.
Il s’ensuit un programme de plantations qui prend appui
sur le plan de gestion arboricole élaboré par
la DEVE pour la période 2006-2020.
2006-2009
: vers un bois-forêt
|

©
doc. Apur- Source : plan de l’abbé Jean Delagrive (1728) |

1730
: la forêt et les chasses royales |
|
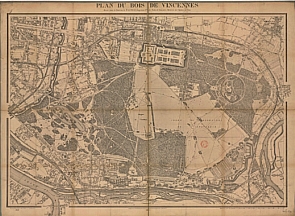
©
gallica.bnf.fr/Bibliothèque Nationale de France |
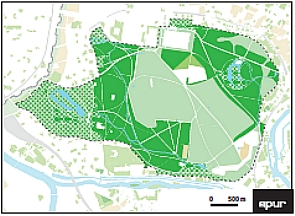
1850
: les travaux d’Alphand |
|
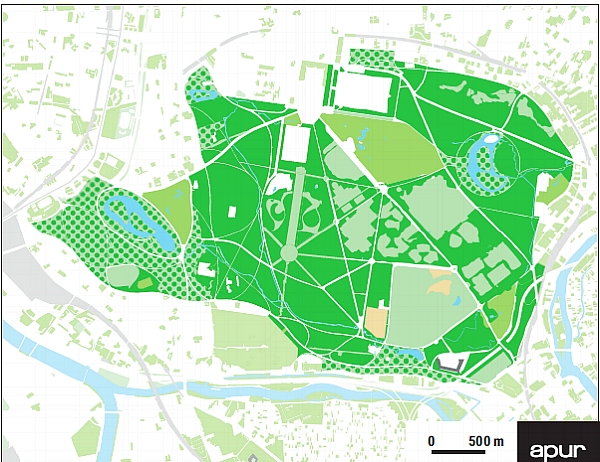 |
|
|
(1)
La Charte du bois de Vincennes
Elle
a été signée le 26 avril 2003 par
les maires de Charenton-le-Pont, Paris, Fontenay-sous-Bois, Joinville-le-Pont,
Maisons-Alfort, Nogent-sur-Marne,
Saint-Mandé, Saint-Maurice, Vincennes,
le président du Conseil régional
d’Île-de-France et le président
du Conseil général du Val-de-Marne. |
|
|
| Le
patrimoine
Le
patrimoine paysager du bois de Vincennes est le fruit d’une
succession d’époques qui ont transformé le
bois en gommant l’essentiel des traces précédentes,
dessinant un paysage fait d’une mosaïque d’espaces
et d’ambiances différentes.
Le
bois de Vincennes présente une grande diversité
d’ambiances et de paysages, auxquels sont associés
des usages souvent distincts. Cette diversité ne se limite
pas aux paysages naturels, elle concerne aussi les grandes perspectives
et les vues lointaines, les bâtiments, les enclos, les voies
de circulation et de promenade, les parcs de stationnement, le
mobilier et leur insertion paysagère.
Le
patrimoine qui s’étend sur 543 hectares, partie centrale
du bois de Vincennes, a de nombreuses fois été remanié,
rasé, replanté, divisé en deux massifs, pour
se recomposer aujourd’hui dans l’optique de retrouver
un massif unique renouant avec les qualités de forêt
dense au caractère naturel.
Il occupe aujourd’hui un peu moins de la moitié de
la surface du bois. Le plus grand massif (plus de 300 ha) est
situé au centre du bois. Structuré par les grandes
perspectives de l’allée Royale, du rond-point et
ses allées rayonnantes, ce massif a retrouvé un
caractère de forêt avec la fermeture à la
circulation de la route de la Tourelle en 1996. La quiétude
installée sur un cinquième environ de la superficie
du bois a permis le retour d’une petite faune et a rendu
étonnamment paisibles les promenades forestières.
Le second massif (150 ha) se développe au nord-est, autour
du lac des Minimes. Il est séparé du premier par
les équipements publics ou privés qui ont pris place
de part et d’autre de l’avenue de la Pyramide, sur
d’anciens terrains d’exercices militaires. Bien qu’il
soit traversé par de grandes routes circulées, ce
massif forestier a néanmoins connu une amélioration
de son ambiance sonore en 1999, lorsque le tronçon encore
pratiqué de la route circulaire du lac des Minimes a été
neutralisé. La fermeture, le dimanche, de plusieurs routes
circulées dans le cadre de Paris Respire en agrémente
encore la fréquentation, notamment depuis les communes
de Vincennes et de Fontenay-sous-Bois.
Mise
en scène paysagères du Grand Rocher du Parc zoologique
sur le lac Daumesnil ©
Apur - JC Bonijol
La
tempête Lothar de 1999, en abattant 210 ha de massif, principalement
les peuplements forestiers anciens, a permis de procéder
à un fort rajeunissement et une grande opération
de densification des massifs, privilégiant les essences
régionales et un mode de gestion forestier.
Ce programme de plantation prend appui sur le plan de gestion
arboricole 2006-2020. Ce plan décrit la typologie des espaces
du bois déterminée en fonction de caractéristiques
évaluées en termes de qualité paysagère,
de patrimoine écologique, de fréquentation et de
gestion, et détaille l’évolution des parcelles
attendue d’ici 2020. Cette évolution concerne plus
de 80 hectares et traduit un objectif de renforcement des caractéristiques
forestières pour amener la forêt au plus près
de la ville, relier les deux massifs par des continuités
forestières pour refermer la large blessure centrale causée
par les défrichements militaires réalisés
à partir de la révolution et jusqu’au milieu
du XIXe siècle. Les cartes de comparaison des hauteurs
de végétation de 2005 et 2015 (cf. page 38) illustrent
parfaitement les effets significatifs de cette gestion, notamment
sur les deux grands massifs forestiers cités, mais aussi
au sud de l’INSEP, et autour des concessions qui séparent
les deux massifs.
Patrimoine
paysager du bois
Ce
massif forestier comporte deux types de densité :
-
les massifs forestiers denses, où la fréquentation
est modérée, sont principalement des espaces où
l’on se promène sans s’arrêter longtemps
;
-
les massifs forestiers clairiérés, c’est-à-dire
accompagnés de clairières de petites dimensions
se situant principalement autour de l’allée Royale,
aux abords du lac des Minimes ou en lisière de Fontenay-sous-Bois.
Les abords boisés du lac des Minimes, à l’instar
des aménagements paysagers des autres lacs du bois, connaissent
des sur-fréquentations chroniques. Les clairières,
l’allée Royale et les autres grandes allées
du coeur de bois – lieux de promenade et de séjour
– présentent les mêmes usages mais à
l’écart du bruit et de la forte fréquentation.
Les
autres espaces du bois requièrent des moyens plus importants
pour leur entretien, à la mesure d’une fréquentation
nettement supérieure de ces emprises. Ils répondent
à une demande sociale très forte d’espaces
polyvalents et d’espaces paysagers, faciles d’accès
et sûrs. Ils se composent de :
-
Les massifs forestiers clairsemés s’étendent
sur 85 ha et sont caractérisés par un peuplement
arboré hétérogène sur prairie. Il
est présent en rive de Vincennes et de Saint-Mandé
ou en rives des plaines de sport. La gestion de ces espaces
fait notamment appel au fauchage différencié.
En laissant par endroits des herbes hautes, cette technique
vise à réduire la profondeur du champ visuel d’une
personne assise pour que la forte fréquentation de ces
espaces soit ressentie moins négativement. Elle permet
également de maintenir et de favoriser une diversité
écologique de la faune.
Perspective
sur le château de Vincennes depuis l’allée
Royale
©
Apur - JC Bonijol
-
Les prairies arborées, caractérisées par
leur grande ouverture, sont présentes au nord de Charenton-le-Pont
et près du lac de Gravelle. Les horizons sont larges
et les essences assez variées. Les prairies font également
l’objet d’un fauchage différencié.
Mais entre Charenton-le-Pont et le lac Daumesnil, la proximité
des voies de circulation, du champ de foire et des fêtes
à l’Institut Bouddhique réduit leur qualité
d’usage.
-
Les espaces paysagers ou jardinés aménagés
en parcs urbains périphériques, héritages
de l’art d’Alphand, totalisent 51 ha et s’apparentent
par leur gestion aux parcs et aux squares qui existent dans
Paris. Les pelouses sont ici plus soignées, jardinées,
parfois entourées de grilles basses. Les essences et
les plantes rencontrées sont très variées
et il existe de beaux arbres isolés. C’est notamment
le paysage des lacs Daumesnil et de Saint-Mandé. Pour
beaucoup, aller au bois de Vincennes se limite à visiter
ces espaces. Souvent sur-fréquentés, ces derniers
souffrent de fortes dégradations.
- Les
plaines de jeux en accès libre forment un paysage ouvert
de 25 ha.
Un système bocagé y a été créé
pour permettre aux promeneurs de franchir les plaines de jeux
sans conflit avec les sportifs mais aussi pour intégrer
ces espaces au paysage du bois.
D’autres espaces du bois bénéficient de
modes de gestion comparables à ceux des espaces paysagers
ouverts et des abords des lacs. Ainsi, le Parc Floral, les squares,
l’École d’Horticulture du Breuil, le Parc
zoologique ainsi que l’hippodrome bénéficient
d’une gestion horticole soignée : mise en valeur
des collections botaniques et horticoles, des massifs floraux
ou arbustifs taillés et régulièrement remplacés,
tonte fréquente et arrosage régulier des pelouses,
collecte des déchets végétaux et des feuilles.
Des
travaux d’Alphand on retient principalement les aménagements
paysagers de Daumesnil, des clairières de Fontenay, de
Saint-Mandé, notamment ; le réseau hydrographique
comptant 9,5 km de rivières et 4 lacs ; les systèmes
de perspectives profitant de la situation en belvédère
de la route de Gravelle pour ouvrir des vues généreuses
sur le grand paysage parisien, ou composant plus finement avec
les pleins et les vides dans ses aménagements pour donner
de la profondeur et de l’agrément et mettre en scène
les bâtiments et ouvrages construits dans le bois. À
la trame sinueuse des aménagements d’Alphand, se
sont superposés les tracés rectilignes imaginés
par Trouvelot à qui est confié l’aménagement
du bois et sa replantation après la seconde guerre mondiale.
Il opte alors pour reconstituer les grandes compositions des chasses
royales, et ainsi relier le bois à l’histoire du
château de Vincennes. C’est notamment pour ce double
héritage que le bois de Vincennes a été classé
au titre des sites naturels pittoresques en 1960 par André
Malraux.
Près de 25 km d’alignements d’arbres datent
de la seconde moitié du XIXe siècle. Si la tempête
a accéléré le processus de régénération,
l’état phytosanitaire et la densité des arbres
encore présents imposent un ordre de priorité pour
leur renouvellement, particulièrement sur les avenues du
Tremblay et de Nogent. Les nouvelles plantations sont plus espacées
(7 à 10 m au lieu de 5 m) et la DEVE limite certaines essences
comme les marronniers, autrefois dominants, du fait des ravages
causés par la mineuse du marronnier. Les essences sont
choisies en fonction des types de voies et de leur histoire, mais
aussi des peuplements existants. Elles participent ainsi à
l’articulation de différents types de parcelles forestières
et à la continuité des paysages.
La préservation de ces caractéristiques, identifiées
dans le plan de gestion arboricole 2006-2020, sera poursuivie
et enrichie dans le cadre de son renouvellement qui prévoit
:
-
La restauration des compositions paysagères historiques
-
La préservation et le développement de la biodiversité
-
La prise en compte de l’évolution des usages.
Hêtre
vert pleureur, square Carnot, Paris XIIe :
Le bois de Vincennes compte 24 arbres remarquables dont 7 sur
l’île de Bercy
du lac Daumesnil. Ces arbres sont distingués pour leur
intérêt paysager,
leur silhouette, leurs dimensions exceptionnelles, leur intérêt
horticole,
ou encore leur rareté. ©
DEVE - Aurélia Chavanne |

©
Christophe Jacquet – Ville de Paris
|
|
 |
La
quiétude installée sur un cinquième environ
de la superficie du bois a permis le retour d’une petite faune
et a rendu étonnamment paisibles les promenades forestières. |
|
|
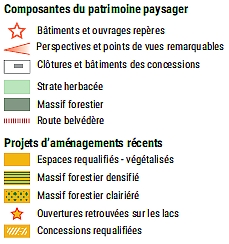 Source
: DEVE Source
: DEVE
|
|
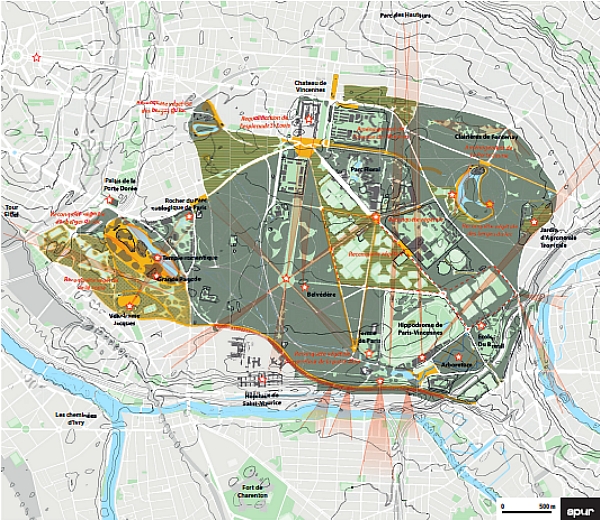
 |
|

Resserrement
progressif des perspectives historiques depuis la colline de Gravelle
©
Apur |

Mise
en scène des pavillons du lac des Minimes
©
Apur |
|

Mise
en scène paysagère et perspective vers le temple de
l’Amour sur le lac Daumesnil
©
Apur - JC Bonijol |

Vue
sur l’hôtel Motel One Paris-Porte Dorée depuis
l’île de Reuilly, lac Daumesnil
© Apur - JC Bonijol
|
|

Les
douves du Fort Neuf de Vincennes :
une ZIEP en réflexion
©
Apur |

Le
square Carnot, une entrée de bois dans le style des parcs
paysagers parisiens du XIXe siècle
©
Apur |
|
 |

Densification
des plantations forestières
sur le secteur des plaines de jeux
©
Apur |
|

Hauteur
de la végétation en 2005 |

Hauteur
de la végétation en 2015
|
|
...
.....
...... .Ouvrage
Les bois de Boulogne et de Vincennes : 1840 hectares
de nature à revisiter .Ouvrage
Les bois de Boulogne et de Vincennes : 1840 hectares
de nature à revisiter
.................Atelier
parisien d’urbanisme
......... |
|
| |
Les deux bois restent
encore des espaces fragmentés, à la
fois par les infrastructures routières et par
les concessions qui les morcellent. L’enjeu
est d’atteindre un juste équilibre entre
les différents usages, les activités
économiques, la préservation et la valorisation
du patrimoine paysager et bâti et le développement
de la biodiversité.
L'ouvrage présente, 17 ans après les
Chartes des bois, un diagnostic mettant en avant,
dans une vision holistique, les actions réalisées,
et esquisse des pistes d’évolutions.
Aujourd’hui, à la fois l’urgence
climatique, les nouvelles attentes des citadins, et
l’exigence patrimoniale nous invitent à
engager une nouvelle étape de développement
des deux bois. Ce diagnostic prospectif peut constituer
un socle commun pour nourrir les échanges et
choix à venir par la Ville de Paris et les
collectivités riveraines.
|
|
|
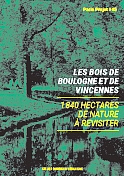
©
Apur - Bois de Vincennes
|
.....
©
Atelier parisien d’urbanisme, Paris 2020
Directrice
de la publication : Dominique ALBA, directrice générale
de l’Apur
Directrice de la rédaction : Patricia PELLOUX,
directrice adjointe - Rédacteurs en chef
: Patricia PELLOUX et Frédéric BERTRAND
Étude réalisée par : Frédéric
BERTRAND, Florence HANAPPE, Vincent NOUAILHAT, Yann-Fanch
VAULÉON - Avec le concours de : Anne-Marie
VILLOT
Cartographie et traitement statistique : Marie-Thérèse
BESSE, Christine DELAHAYE, Tristan LAITHIER, Nathan PAULOT
Photographies et illustrations : Apur sauf mention
contraire
Dépôt
légal : mai 2020 - ISBN : 978-2-36089-017-0 - ISSN
: 1773-7974
apur.org |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() Ouvrage
Les bois de Boulogne et de Vincennes :
Ouvrage
Les bois de Boulogne et de Vincennes :

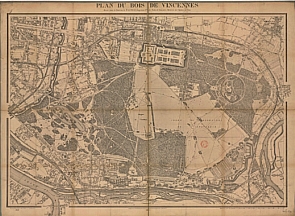
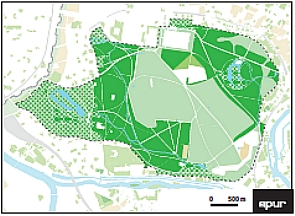
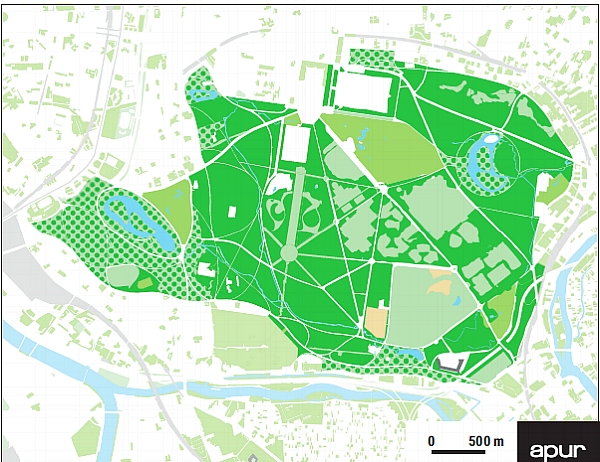
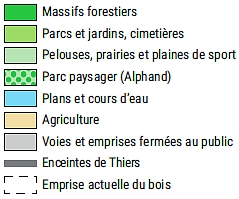

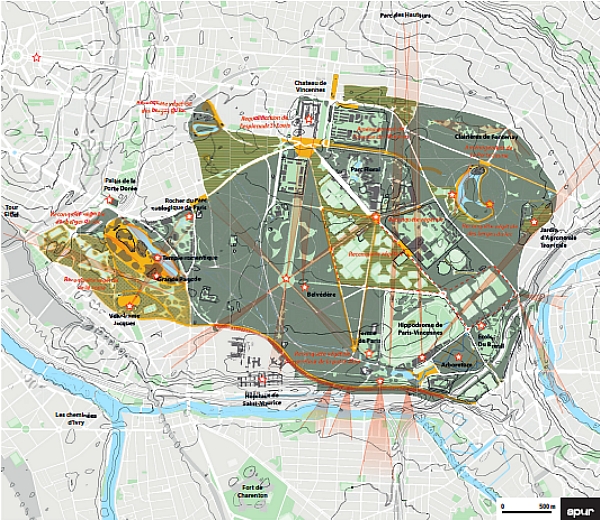











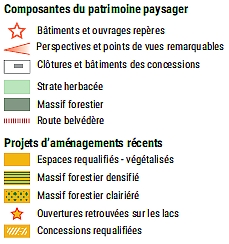 Source
: DEVE
Source
: DEVE