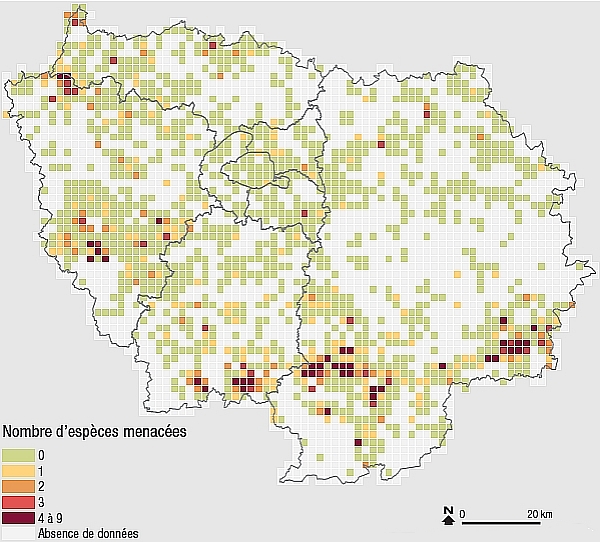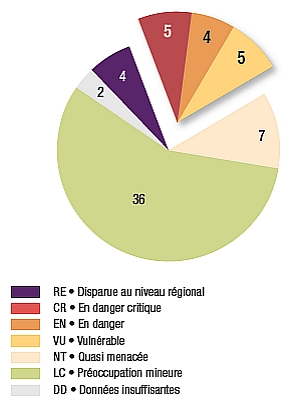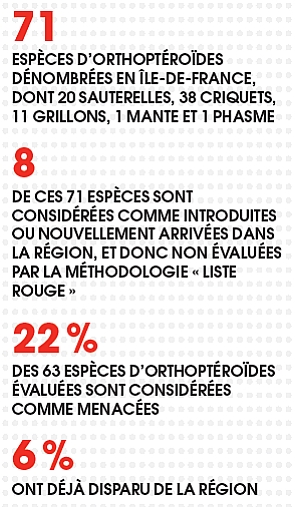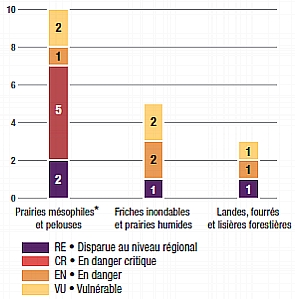|
Le
peuple de l'herbe francilien a été évalué
pour la première fois dans le cadre de la Liste rouge régionale
des Orthoptéroïdes, réalisée par l'Agence
régionale de la biodiversité en Île-de-France - ARB
ÎdF - en partenariat avec l'Office pour les insectes et leur environnement,
OPIE.
Celle-ci dresse un bilan inquiétant et préconise les actions
à mettre en œuvre en priorité pour la conservation
de ces insectes
essentiels au bon fonctionnement des écosystèmes.
Introduction
Les résultats sont sans appel : 22 % des Orthoptéroïdes,
groupe taxonomique incluant criquets, grillons, sauterelles,
mante religieuse et phasme gaulois, sont menacés d’extinction
dans la région. En cause, l’agriculture intensive,
l’artificialisation des sols et la pollution des milieux,
dans un contexte de changement climatique. L’extinction
des Orthoptéroïdes, comme celle des autres insectes,
peut avoir des effets dévastateurs sur les écosystèmes
et les services qu’ils nous rendent.
Les Orthoptères, ou Orthoptéroïdes,
sont des insectes remarquables, rencontrés dans la quasi-totalité
des milieux terrestres. Dans le monde, on compte près
de 28 500 espèces décrites. La faune francilienne
recense actuellement 71 espèces, dont 20 sauterelles,
11 grillons, 38 criquets, une mante et un phasme. Ces insectes
sont étroitement liés à leur environnement
: pour la plupart des espèces, les œufs et larves
hivernent au sol ou dans la strate herbacée ; les adultes,
quant à eux, vivent dans la végétation
et peuvent être herbivores, pour la majorité des
criquets, ou omnivores, pour certaines sauterelles. Ces insectes
jouent divers rôles essentiels au bon fonctionnement des
écosystèmes. La consommation de végétaux
de nombreuses espèces permet de limiter le développement
de la végétation et de recycler la matière
organique. Généralement très abondants,
les Orthoptères représentent aussi une manne alimentaire
conséquente pour les oiseaux, mammifères, reptiles
et autres insectes carnivores. Enfin, les sauterelles prédatrices
régulent les populations de petits insectes et invertébrés,
dont certains représentent une menace pour l’agriculture.
|
|
| Le
processus d'extinction des Orthoptéroïdes
Des
espèces menacées pour certaines, déjà
disparues pour d'autres
La
Liste rouge régionale des Orthoptéroïdes évalue
l’état de santé de ce groupe d’insectes
en Île-de-France. Les résultats indiquent que 14
espèces sur les 63 évaluées (22 %) sont considérées
comme menacées d’extinction, et quatre (6 %) ont
déjà disparu de la région.
Outre ces espèces éteintes dans la région
[RE, voir le camembert ci-contre, plus bas], celles menacées
d’extinction se répartissent en trois catégories
bien distinctes : les espèces en danger critique [CR],
qui risquent de disparaître d’ici dix ou quinze ans
; celles en danger [EN] et vulnérables [VU].
En dehors de ces trois catégories, on retrouve également
les espèces quasi menacées [NT], qui subissent
des pressions importantes, et pourraient, lors de la prochaine
actualisation de l’évaluation - prévue tous
les cinq à dix ans -, devenir menacées.
Le reste des espèces est réparti entre le statut
préoccupation mineure [LC] qui indique que, dans
l’immédiat, il n’y a pas d’enjeu urgent
à leur conservation et le statut données insuffisantes
[DD], qui s’applique lorsque les connaissances sont
trop parcimonieuses pour évaluer l’état de
conservation de manière objective.
Il est important de garder à l’esprit que, même
si une espèce est en préoccupation mineure,
cela ne signifie pas que son état s’améliore.
Dans la majorité des cas, toutes voient leurs populations
diminuer, mais certaines sont dans des états plus critiques
que d’autres. C’est là tout l’objectif
de ce travail : hiérarchiser les priorités.
Les
différents territoires franciliens ne sont pas tous égaux
face à ces chiffres. La répartition des espèces
menacées est très hétérogène
dans la région.
Certains secteurs, remarquablement riches, constituent d’importants
réservoirs de biodiversité qu’il est impératif
de préserver. Parmi ces hot spots, la forêt de Fontainebleau,
le massif de Rambouillet et les Réserves naturelles nationales
(RNN) de la Bassée et des Coteaux de la Seine, hébergent
une grande partie des espèces aux situations les plus précaires.
Ces sites, relativement préservés, constituent un
ultime refuge pour des espèces liées à des
habitats naturels bien spécifiques, qu’on ne retrouve
plus ailleurs en Île-de-France, en raison des pressions
humaines.
Des
espèces liées au destin de leurs habitats
Les
Orthoptéroïdes constituent, en majorité, un
véritable peuple de l’herbe, qui dépend
des milieux ouverts pour leur cycle de vie. Les prairies - sèches
ou humides -, les landes, les fourrés, les friches humides
et les pelouses calcaires - prairies à la végétation
très rase - sont les habitats typiques de ces insectes.
Or, ces milieux naturels sont aussi ceux qui ont le plus régressé
ces dernières décennies en Île-de-France :
de nombreuses espèces se retrouvent ainsi directement impactées
par leur disparition.
Entre 2000 et 2017, près de la moitié des prairies
sèches et humides d’Île-de-France ont disparu,
tandis que les landes et les fourrés régressaient
de près de 25 % (1). Ce phénomène se traduit
par le nombre important d’espèces affiliées
à ces milieux qui sont considérées comme
menacées.
Le fort lien qui existe entre ces insectes et leurs habitats permet
de les qualifier d’espèces bio-indicatrices.
Cela signifie que l’état de santé de certaines
espèces spécifiques traduit le bon fonctionnement
des écosystèmes qu’elles habitent. Ainsi,
le fait qu’une espèce bio-indicatrice soit dans un
état de menace préoccupant, sous-entend que d’autres
espèces qui partagent ce lieu de vie sont également
fragilisées
selon leur catégorie de menace (voir
ci-contre : Répartition
des espèces menacées par grand type de végétation).
Les Orthoptères sont aussi des organismes parapluie
: la mise en œuvre d’une gestion favorable pour
ce groupe bénéficiera à l’ensemble
des espèces, animales et végétales, ayant
des exigences écologiques similaires. Autrement dit, adapter
la gestion et la restauration des milieux naturels aux besoins
de ces insectes permet de considérer ceux de la grande
majorité des autres organismes vivants, en particulier
dans les milieux ouverts : pelouses, prairies et landes.

|
Répartition des espèces d’Orthoptéroïdes
quasi menacées et menacées
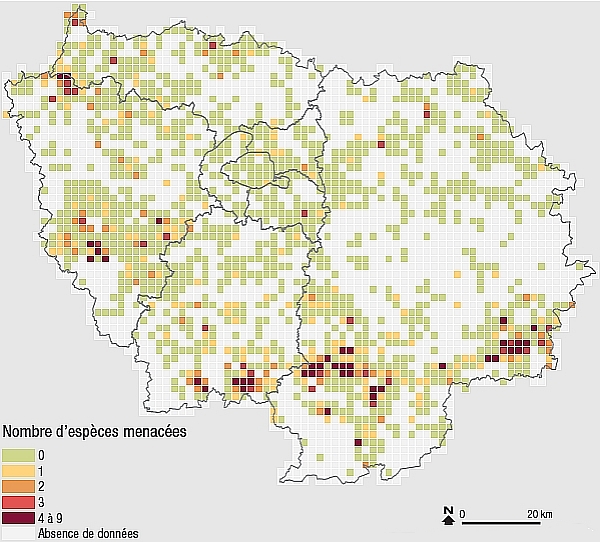 |
|
Sur
63 espèces évaluées,
près d’un quart sont menacées
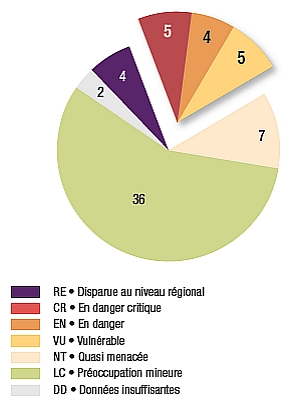 |
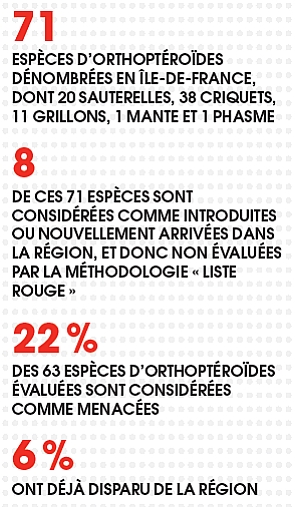 |
|
|
Répartition
des espèces menacées
par grand type de végétation (2)
selon leur catégorie de menace
prairies
mésophile*
: Le terme mésophile qualifie l’humidité
moyenne d’un milieu :
on s’intéresse donc ici aux prairies moyennement
humides.
Un
Criquet palustre
(Pseudochorthippus montanus)
© Hemminki
Johan/L’Institut Paris Region |
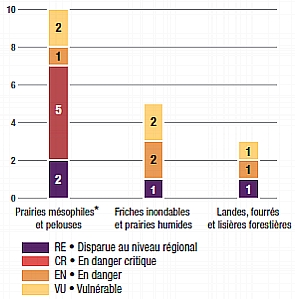 |
|
Les
causes de leur disparition
L’agriculture
intensive, l’artificialisation des sols et la pollution
des milieux sont les trois principales causes de la disparition
des Orthoptères - et de la biodiversité en général
- en Île-de-France.
Disparition des habitats, intoxication des individus, perturbation
des rythmes biologiques et fragmentation des corridors sont
autant de conséquences de l’action humaine qui
dégradent la résilience des espèces face
aux changements globaux.
Les
terres agricoles représentent près de la moitié
(49 %) du territoire rancilien. La modernisation de l’agriculture
et l’intensification des pratiques, avec l’épandage
de produits phytosanitaires, l’utilisation de traitements
vétérinaires antiparasitaires dans les élevages
et le recrutement de terres pour les cultures - conversion des
prairies en monoculture -, ont participé au déclin
des insectes et, notamment, des Orthoptères.
Le remembrement agricole a aussi participé au mitage
des habitats en affectant corridors et trames. Même si
l’Île-de-France n’a jamais été
une véritable région de bocage, elle a toujours
connu la présence de haies, de ripisylves ou de bandes
enherbées qui ont joué ce rôle de connexion
entre les milieux favorables aux espèces. En plus de
la disparition de ces composantes linéaires du paysage,
il faut ajouter l’apparition d’autres éléments
- cette fois fragmentants - qui morcellent le territoire. Les
infrastructures routières et ferroviaires, conjointes
à une urbanisation galopante, ont terminé d’achever
un patchwork inadapté aux déplacements des espèces.
Ces liens, au-delà d’être de simples voies
de déplacement pour les espèces, sont aussi indispensables
pour permettre la recolonisation de sites renaturés ou
pour assurer la stabilité génétique des
populations à long terme.
L’extension des zones urbaines participe également
à la dégradation directe ou à la fragmentation
des habitats naturels dans lesquels vivent les populations d’insectes.
Les pollutions chimiques, issues des concentrations urbaines
- métaux lourds, dioxines, molécules médicamenteuses,
microplastiques… -, contaminent l’environnement
de manière chronique. En s’accumulant dans les
milieux naturels adjacents, puis en se diffusant passivement,
ces produits et substances nocifs intoxiquent les réseaux
trophiques, c’est-à-dire la chaîne alimentaire.
À l’échelle des organismes, ces substances
altèrent les capacités des individus - nourrissage,
mobilité, reproduction… -, surtout en cas de fortes
concentrations.
Un
changement climatique aux effets contrastés
Les
dernières décennies sont marquées par l’accélération
du dérèglement climatique. Dans ce contexte, ce
sont les espèces dites méridionales qui
se retrouvent généralement favorisées par
des températures plus clémentes. Elles progressent
au sein de la région, en investissant les habitats chauds
et secs, qui leur sont bénéfiques. Par conséquent,
des espèces autrefois considérées comme
rares, patrimoniales et caractéristiques
des pelouses et des prairies sèches de la vallée
de la Seine - plaine alluviale et coteaux - se retrouvent désormais
en abondance dans toute la région. En revanche, le changement
climatique entraîne le recul de certaines espèces
aux affinités nordiques, de répartition
eurosibérienne. Ces dernières ont des
populations fragiles dans la région et, souvent, leur
migration vers le nord est impossible, par manque d’habitats
favorables à leur dispersion - morcellement des milieux
naturels - ou parce que leurs traits biologiques - ailes atrophiées
- ne permettent pas des déplacements efficaces. La Decticelle
des alpages est une sauterelle surtout présente dans
les massifs montagneux, où elle affectionne les prairies
humides des grands plateaux herbeux. En Île-de-France,
elle était citée dans la forêt de Notre-Dame
au siècle dernier, mais y est manifestement éteinte
aujourd’hui. Victime de l’embroussaillement des
prairies, de leur assèchement et du réchauffement
climatique, cette espèce est de plus en plus repoussée
en altitude où elle trouve encore les biotopes et les
conditions climatiques favorables à son développement.
Le
pâturage : vers une meilleure gestion écologique
des milieux ouverts
Malgré
ces constats accablants, il existe des solutions à mettre
en œuvre pour enrayer la tendance. Qu’il s’agisse
d’espaces naturels, de parcs urbains ou même de
jardins, la gestion de ces espaces est parfois responsable de
l’appauvrissement de la biodiversité. Les criquets
et les sauterelles étant directement liés à
la dynamique de la végétation, ces insectes bénéficient
globalement des modalités de gestion visant à
maintenir un milieu herbacé qui évoluera au rythme
des saisons en prohibant une coupe rase pendant les périodes
d’activité. Dans les espaces naturels, les principales
menaces qui pèsent sur les espèces sont l’abandon
des pratiques pastorales et la colonisation par les arbres ;
on dira alors du milieu qu’il se referme.
Le pâturage extensif est le mode de gestion écologique
le plus adapté aux Orthoptéroïdes. Celui-ci
est le plus souvent préconisé pour entretenir
l’hétérogénéité
structurelle et la diversité spécifique des milieux
ouverts. Contrairement aux méthodes mécaniques,
il permet la création d’irrégularités,
favorables aux insectes, produites par les refus du bétail
et l’action inégale des mâchoires sur les
végétaux. Néanmoins, la mise en pâturage
provoque, en premier lieu, une baisse notable de la densité
des effectifs d’Orthoptères, pouvant même
conduire à la disparition temporaire de certaines espèces.
Le gestionnaire veillera ainsi à mettre en défens
une zone refuge tournante qui puisse constituer un
réservoir mobile, permettant la recolonisation des secteurs
rendus de nouveau favorables à la suite du passage du
bétail.
Fauche
et débroussaillage : des pratiques parfois délétères
Pour
exploiter ou entretenir les prairies, la fauche s’avère
beaucoup moins favorable que le pâturage car elle casse
directement le cycle de développement de ces insectes
en majorité herbivores. La mécanique de coupe
et de récolte du foin détruit un grand nombre
d’individus adultes et livre les survivants à la
merci de prédateurs. Si la fréquence de fauche
dépasse une à deux coupes par an, elle s’avère
même catastrophique pour la majorité des espèces.
Une fauche irrégulière ou partielle - alternance
de zones fauchées et non fauchées - peut cependant
représenter ponctuellement un mode de gestion satisfaisant,
en particulier en zone humide. Elle peut être préférée
au pâturage dans les marais ou les prairies humides, notamment
si la surface est restreinte et ne peut s’envisager comme
une pâture. La fauche doit impérativement prévoir
une zone refuge.
Enfin, dans certains cas, les faciès de végétation
- au sens de la stratification végétale - devenus
embuissonnés ou embroussaillés par les
arbustes ne sont plus favorables aux espèces caractéristiques
des milieux herbacés. Un débroussaillage ne peut
s’envisager seul : il est très souvent mobilisé
en soutien au pâturage, qui permettra ensuite de maintenir
le caractère herbacé du milieu géré.
Dichotomie
entre constats et résultats
Voici
donc l’état de santé des Orthoptères
d’Île-de-France. Alors qu’un nouveau rapport
du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution
du climat (GIEC) est paru, et que les indicateurs sur l’état
de la biodiversité tirent chaque année la sonnette
d’alarme, force est de constater que les actions semblent
insuffisantes face à l’urgence des enjeux. Cette
dernière Liste rouge régionale, réalisée
dans la continuité des cinq précédentes
- oiseaux, plantes vasculaires, chauves-souris, papillons de
jour et libellules -, ne fait pas exception à la règle,
en dressant un portrait préoccupant de l’état
de la biodiversité francilienne. Or, au-delà d’être
une représentation de la situation à un instant
t, l’objectif des Listes rouges régionales est
également de permettre un suivi de l’évolution
des menaces qui pèsent sur les espèces grâce
à leur actualisation, en général tous les
cinq à dix ans. À l’heure actuelle, deux
Listes rouges franciliennes ont bénéficié
de cette actualisation - oiseaux et plantes vasculaires -, les
résultats demeurent préoccupants. Par exemple,
pour les oiseaux entre 2011 et 2018, on constate une augmentation
de 50 % du nombre d’espèces considérées
comme menacées. L’inflexion de la dangereuse courbe
de disparition des espèces semble encore lointaine.
|
Portraits
d’espèces franciliennes
Quelques
espèces sont esquissées à travers leur écologie,
leurs traits de vie originaux ou encore l’état de
conservation alarmant de leurs populations dans la région.

Mante
religieuse ©
Pierre
Tillier
|
|
|

©
Xavier Houard
Grillon
bordelais
On
retrouve ce petit grillon, historiquement assez répandu
dans la moitié sud du pays, dans une large gamme d’habitats,
comme les vignes, les champs cultivés ou les pelouses sèches.
Depuis une vingtaine d’années, l’espèce
a entamé une progression vers le nord, notamment grâce
aux voies ferrées, de sorte qu’on la retrouve désormais
sur la majorité du territoire. Assez opportuniste, le Grillon
bordelais est aujourd’hui observable au cœur de Paris,
et même dans des endroits inusités comme certaines
toitures végétalisées.

©
Aiwok
Grillon
domestique
Le Grillon domestique est une espèce adaptée aux
infrastructures et aux habitations, au point qu’il lui est
devenu difficile de vivre sans la présence de l’homme.
Originaire du Moyen-Orient, ce grillon a probablement bénéficié
du commerce des épices au Moyen Âge pour s’installer
en Europe. Affectionnant la chaleur, on le retrouvait alors particulièrement
chez les boulangers, sous les fours à bois, profitant de
températures clémentes toute l’année.
Plus tard, d’importantes populations se sont établies
dans les ballasts du métro parisien, qui ont l’avantage
de conserver la chaleur tout en offrant une large gamme de déchets,
dont profite cet insecte opportuniste. Aujourd’hui, l’espèce
s’est considérablement raréfiée, et
ne subsiste plus que dans quelques stations de métro -
sur les lignes 9 et 3, notamment -, conséquence de la disparition
des ballasts sur certaines rames, et de l’amélioration
de la propreté des voies.

©
Hemminki Johan/L’Institut Paris Region
Courtilière
commune
Également appelé grillon-taupe, cet insecte
passe la quasi-totalité de sa vie sous terre, à
l’instar d’une taupe. Parfaitement adaptée
à cette vie souterraine, la Courtilière possède
des pattes antérieures modifiées, très robustes,
qui lui permettent de creuser des galeries. Si elle est difficile
à observer directement, on peut communément entendre
les stridulations aiguës des mâles qui peuvent même
devenir assourdissantes dans les environnements où l’espèce
prospère. Longtemps considérée comme un ravageur
de cultures par les jardiniers et les maraîchers, cette
espèce a subi d’importantes campagnes de destruction
des individus et des terriers. Victime de cette réputation,
la Courtilière, autrefois commune, est devenue rare
et ne semble désormais que se maintenir sur les prairies
humides préservées.
Elle est évaluée comme quasi menacée
[NT] sur le territoire francilien. |

©
Jérémy Thomas
Dectique
verrucivore
Cette
sauterelle massive, pouvant dépasser 4 cm à l’âge
adulte, est un exemple flagrant des effets du réchauffement
climatique sur la biodiversité. Son nom, verrucivore,
viendrait d’une ancienne croyance populaire, largement répandue
en Europe, selon laquelle se faire mordre une verrue par cet insecte
permettait de s’en débarrasser grâce aux sucs
intestinaux crachés par l’insecte quand il se sent
en danger. On ignore si la méthode a donné de bons
résultats à l’époque, mais, aujourd’hui,
vu la rareté de cette espèce, mieux vaut recourir
à la médecine moderne. Sa répartition en
fait une espèce typiquement boréo-montagnarde, affectionnant
les pelouses rases d’altitude. Dans le nord de son aire
de répartition, elle s’est considérablement
raréfiée durant les dernières décennies
se montrant très sensible aux modifications des milieux
naturels et aux effets du réchauffement climatique. En
Île-de- France, l’espèce est considérée
comme en danger critique d’extinction, malmenée par
la disparition de ses habitats et leur fragmentation par les infrastructures.

©
Xavier Houard
Phanéroptère
méridional
Cette élégante sauterelle entièrement verte
est facilement confondue avec son proche parent, le Phanéroptère
commun. Comme son nom l’indique, cette sauterelle est d’affinité
plutôt méridionale. En Île-de-France, elle
était cantonnée sur les pelouses sèches et
les coteaux bien exposés de la vallée de la Seine.
Depuis une vingtaine d’années, elle profite du réchauffement
climatique et de l’îlot de chaleur urbain pour venir
s’installer dans les parcs urbains et les friches, franchissant
aisément les barrières urbaines grâce à
sa bonne capacité à voler sur de longues distances.

©
Guillaume Larregle
Tétrix
des vasières
Ce criquet au mode de vie étonnant est particulièrement
discret dans son environnement et passe facilement inaperçu,
sa taille ne dépassant guère un centimètre.
En Île-de-France, on le retrouve aux abords des mares et
des zones humides bien exposées, où il prospère
dans les vasières. Sa petite taille et son habitat en font
un herbivore spécialisé dans la consommation des
petites plantes aquatiques et des mousses qui se développent
sur les vases toujours humides. Ce mode de vie, à l’interface
entre l’eau et le sol, a d’ailleurs permis à
l’espèce de développer des compétences
de nage remarquables. Ainsi, à l’approche d’un
danger, il n’hésite pas à sauter dans l’eau
pour s’échapper, avant de rejoindre le bord en nageant
à l’aide de ses pattes postérieures. Les caractéristiques
de son milieu de vie en font une espèce particulièrement
sensible à l’assèchement des zones humides
et au réchauffement climatique. |
|
(1)
Source : Évolution des milieux d’intérêt
écologique entre 2000 et 2017, page 47 dans L’Environnement
en Île-de-France, édition 2022, L’Institut Paris
Region, mai 2022.
(2) Fernez T., Lafon P. & Hendoux F., Guide des végétations
remarquables de la région Île-de-France. Conservatoire
botanique national du Bassin parisien, Direction régionale
et interdépartementale de l’environnement et de l’énergie
d’Île-de-France, Paris, 2015. |
|
Des
insectes chanteurs et mimétiques
Les Orthoptères font partie des quelques rares insectes
capables d’émettre un chant,
appelé stridulation. Ce chant, uniquement produit par
les mâles adultes lors de la recherche des femelles, est
spécifique à chaque espèce. Si les chants
des Orthoptères trahissent leur présence, les
observer directement dans leur habitat peut s’avérer
plus délicat, car les Orthoptères sont souvent
mimétiques de leur environnement. Cette caractéristique
leur permet de se camoufler dans leur habitat naturel, limitant
ainsi leur prédation.
|
Des
espèces bio-indicatrices
La Decticelle bicolore, qui s’accommode d’une végétation
haute et sèche, se retrouve dans les pelouses sèches
et les coteaux calcaires de la région, témoignant
ainsi de leur bon état de conservation. Le Criquet ensanglanté,
reconnaissable à ses couleurs vives, est, quant à
lui, strictement inféodé aux prairies inondables
et aux friches humides : des changements d’humidité
- suite à un drainage, par exemple, ou à une fauche
trop importante - peuvent entraîner sa disparition et celle
d’autres espèces partageant les mêmes besoins. |
|
...
.....
 .Note
rapide Près
d'un quart des espèces de criquets, grillons
et sauterelles menacées d'extinction en Île-de-France .Note
rapide Près
d'un quart des espèces de criquets, grillons
et sauterelles menacées d'extinction en Île-de-France
...
La Liste rouge régionale
: un indicateur partenarial
La Liste rouge régionale des Orthoptéroïdes
d’Île-de-France, établie selon
la méthodologie appliquée depuis près
de soixante ans par l’Union internationale pour
la conservation de la nature (UICN), a mobilisé
les associations entomologistes, dont l’Office
pour les insectes et leur environnement, ainsi que
de très nombreux experts et bénévoles.
Le Comité français de l’UICN et
le Muséum national d’Histoire naturelle
(MnHn), en mobilisant l’expertise d’un
vaste réseau de naturalistes et de scientifiques,
appliquent la même méthodologie pour
établir une Liste rouge nationale des espèces
menacées. Ils encouragent toutes les régions
qui le souhaitent à engager l’élaboration
de Listes rouges régionales, afin que chacune
puisse construire son propre état des lieux
de la faune, de la flore et de la fonge (champignons)
de son territoire.
L’Île-de-France s’est engagée
avec une grande efficacité dans cette voie
et a lancé, avec l’appui de l’Agence
régionale de la biodiversité (ARB),
une série de Listes rouges franciliennes. La
Liste rouge n’est pas un simple catalogue d’espèces
associées à une évaluation de
leur risque d’extinction, mais aussi un mécanisme
important de compilation, de synthèse et de
diffusion de données actualisées sur
les espèces considérées. Cet
indicateur doit permettre d’orienter les politiques
et les actions en faveur de la biodiversité,
en cohérence avec les urgences mises en lumière
par ces travaux d’évaluation.
|
|
|
|
...
Directeur
de la publication : Nicolas Bauquet
Directrice de la communication : Sophie Roquelle
Rédacteur en chef : Laurène Champalle
Médiathèque
/ photothèque : Inès Le Meledo, Julie
Sarris
Auteur
: Hemminki
Johan, naturaliste
département Biodiversité – ARB ÎdF
(Magali
Gorce, directrice)
avec la participation de Xavier Houard,
entomologiste-écologue, coodinateur des études
et projets de conservation à l’Opie
(Samuel Jolivet, directeur)
arb-idf.fr |
|

|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() Note
rapide Près
d'un quart des espèces de criquets,
Note
rapide Près
d'un quart des espèces de criquets,