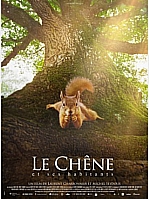![]() Film
Le Chêne et
ses habitants
Film
Le Chêne et
ses habitants
de Laurent Charbonnier et Michel Seydoux
(1)
Note de production
Note
d'intention des réalisateurs
Les personnages : Le chêne
Il
était une fois l’histoire d’un chêne, vieux de
210 ans, devenu un pilier en son royaume. Ce film d’aventure spectaculaire
rassemble
un casting hors du commun : écureuils, balanins, geais, fourmis,
mulots… Tout ce petit monde vibrant, vrombissant et merveilleux
scelle sa destinée autour de cet arbre majestueux qui les accueille,
les nourrit, les protège de ses racines jusqu’à sa
cime.
Une ode poétique à la vie où la nature est seule
à s’exprimer.
| Note de production par Barthélémy Fougea
L’observation du vivant ne se fait plus aujourd’hui
sans une arrière-pensée environnementale, sans
la conscience ambiguë de sa fragilité comme de son
incroyable capacité à s’adapter. De fait,
sa représentation cinématographique non plus.
Parallèlement, notre regard sur la nature s’est
élargi ces dernières années à un
nouvel univers, celui du monde végétal et plus
particulièrement celui des arbres. Comme une nouvelle
frontière, un nouveau paradigme du monde non humain.
Nous avons pris conscience de l’immense richesse de l’univers
de ce grand végétal. Des films documentaires végétaliers
sont nés de cette prise de conscience. Cependant, aucun
n’avait jusqu’à présent appréhendé
l’arbre à travers les trajectoires et enjeux de
ses habitants. C’est précisément cela qui
rend le projet du film Le Chêne si singulier,
et si prompt à un récit de cinéma. Nous
pouvons ressentir de l’intérieur les tensions,
joies, relations, que Le Chêne permet de développer. Les choix de production Ce
choix artistique d’une exploration guidée par les
seuls sens nécessite un travail extrêmement minutieux.
Un important travail de développement a été
mis en œuvre depuis 2017 pour allier rigueur scientifique
et impératifs narratifs avec les scientifiques du Muséum
national d’Histoire naturelle. Les enjeux économiques et industriels du projet Les enjeux artistiques et économiques de ce projet sont très importants pour les trois partenaires. L’ambition de produire un long-métrage sur le vivant qui allie intentions esthétiques et technologiques fortes à destination d’un grand public, est le défi que nous tentons de relever avec ce Chêne. Les 3 photos : © 2022 – Camera One – Winds – Gaumont |


 |
|||||||||||||||||||
| Note d'intention des réalisateurs | ||||||||||||||||||||
| Une histoire Considéré
comme le roi des arbres, le chêne symbolise la puissance
et la pérennité : il est l’arbre le plus grand
et le plus majestueux de nos forêts de l’hémisphère
nord. Pour beaucoup, il est synonyme d’espoir en la vie
pour les générations futures. Une histoire liée aux rencontres Que font un auteur-réalisateur naturaliste passionné et un producteur de cinéma chevronné lorsqu’ils se croisent ? Eh bien, ils se racontent des histoires ! C’est effectivement la rencontre de destins parallèles, ayant le goût de faire partager leur passion au plus grand nombre, qui permet la réalisation de ce film aujourd’hui. Tous les deux, nous avons une sensibilité particulière pour la Nature. Outre la volonté esthétique qui guide ce projet, c’est essentiellement la volonté éthique de sensibiliser à la sauvegarde de notre patrimoine naturel qui nous unit. Le monde sensoriel et poétique du roi des arbres, est un vecteur idéal et si proche de nous pour raconter des histoires, touchantes, vives et intelligibles, comme le sont toutes les grandes histoires de cinéma. Les arbres, et tout particulièrement le chêne, ont une capacité à désigner, à signifier, voire à exercer une influence en tant que symbole. Et il a fallu une dizaine d’années pour que nous puissions développer cette idée pour aboutir à un projet d’envergure. Ainsi la participation de Michel Fessler à l’écriture du scénario et de Vincent Copéret à l’élaboration du storyboard, nous ont permis de mettre en place un film ambitieux parlant de la Nature. Les aspects narratifs Il s’agit ici de prendre un propos documentaire et de le raconter avec le savoir-faire narratif et technique des longs métrages de fictions. Il pourrait s’agir d’un récit naturaliste de cinéma. Mais peu importe la dénomination ou le genre dans lequel classer ce film, l’intention première est de montrer aux spectateurs quelque chose qu’il n’a jamais vu. L’immense richesse de l’univers de ce grand végétal nous permet de raconter des histoires qui touchent le spectateur, du plus petit au plus grand. Quelles que soient son origine ou sa conscience écologique, le but est d’être surpris par l’action, l’image et l’histoire de ce chêne. Les peurs, les joies, les relations inter et intraspécifiques qui se trament dans le monde végétal de ce chêne, sont transmises aux spectateurs avec l’envie de s’immerger dans le regard de nos héros. On voit à la place du mulot qui risque de se faire écraser par les pattes du sanglier. On fait de la voltige comme le geai. On serait presque mouillé par la pluie de la tempête… Appréhender le chêne à travers les trajectoires et les enjeux de ses habitants, comme une fenêtre sur cour naturaliste nécessite d’emprunter les codes modernes des tournages du cinéma de fiction. Au-delà des trouvailles des prises de vues naturalistes à la base du propos du scénario, nous avons fait appel aux dernières technologies audiovisuelles : caméras virtuelles en 360 degrés, machinerie, effets spéciaux… Nous avons aussi innové avec la création de studios macrovidéographiques novateurs, et modifié des équipements techniques standardisés, pour aller à la rencontre du monde microscopique et au cœur du vivant. Pour
beaucoup, le chêne est synonyme d'espoir en la vie |
|
|||||||||||||||||||
| ... Vous
l’aurez compris, en alliant les techniques naturalistes,
le savoir-faire du cinéma de fiction et les nouvelles technologies,
nous avons choisi le parti-pris |
||||||||||||||||||||
| ... Les personnages |
||||||||||||||||||||
 © 2022 – Camera One – Winds – Gaumont |
Le chêne Le
chêne que la science de la systématique range, comme
le hêtre ou le châtaignier, dans la famille des Fagaceae,
est largement répandu dans l’hémisphère
Nord. Plusieurs centaines d’espèces - entre 200 et
600 selon les auteurs - du genre Quercus y sont recensées. Pédoncule y'es-tu ? Comme
son nom l’indique, le chêne pédonculé
possède un pédoncule. Certes, mais de quel pédoncule
s’agit-il ? De celui qui relie le gland au rameau ou de
celui qui relie la feuille au rameau ? Les deux arbres se distinguent également par :
Le chêne colonisateur Une
équipe de chercheurs de l’Unité forestière
de l’INRA a conduit une étude sur l’histoire
de la colonisation du territoire européen par les chênes,
notamment le chêne pédonculé, depuis leur
présence sur Terre dont voici les principales conclusions.
Les premières traces de chênes, identifiées
par des restes fossiles en Amérique du Nord, remontent
à l’Oligocène : il y a 35 millions d’années.
Le genre Quercus explose littéralement vers la
fin du Tertiaire, et on considère que la plupart des espèces
actuelles s’étaient différenciées dès
le Pliocène, il y a 10 millions d’années.
La zone de diversification du genre se situe sans doute en Asie
du Sud-Est ou en Amérique du Nord. À la fin de l’ère
glaciaire, les peuplements de chênes sessiles et pédonculés
sont éclatés en trois zones refuges, isolées
: totalement entre Péninsule Ibérique et les deux
autres refuges, plus partiellement entre l’Italie et les
Balkans. À mesure que le climat se radoucit, les chênes
migrent à partir des trois refuges, d’abord vers
le nord puis dans des directions différentes selon leur
origine. Cette progression s’est faite de manière
extrêmement rapide : à la vitesse moyenne de 380
m par an. Une telle vitesse ne peut être le résultat,
ni du colportage des glands par les hommes, qui migraient eux-aussi,
ni par le déplacement des glands par le geai des chênes
pourtant fort efficace. Des analyses de pollens fossiles nous
apprennent que la colonisation du territoire européen est
le fait de quelques rares épisodes de dispersion massive
de pollens à très longue distance. Le génome du chêne séquencé Des équipes de recherche de l’INRA et du CEA viennent de séquencer le génome du chêne pédonculé. Il s’agit du premier séquençage pour une espèce du genre Quercus très largement répandu dans l’hémisphère nord. Trois années de travaux ont permis de décrypter l’ensemble de l’information génétique portée par ses 12 paires de chromosomes. Les chercheurs ont caractérisé 50 000 gènes et estimé que la moitié des 1,5 milliard de paires de base du génome était constituée d’éléments répétés. Ces travaux permettront notamment de mieux comprendre les mécanismes d’adaptation des arbres aux variations environnementales et fourniront des éléments pour anticiper leurs réponses au changement climatique. Les génomes des arbres seraient, en moyenne, plus lourd et plus volumineux que ceux des animaux. Cette exceptionnelle diversité génétique est-elle la garante de leur capacité à surmonter des modifications ? Ça chauffe aussi pour les chênes Il est désormais avéré que l’intensité et la rapidité des changements climatiques sont telles qu’il faut s’attendre à une disparition des espèces végétales les moins adaptées. Il en va de même pour les chênes. Plus une espèce de chêne aura été confrontée, au cours de son évolution, à des situations de stress climatique, plus elle aura été obligée de s’adapter par le biais de mutations pour parvenir jusqu’à notre époque et plus grande seront sa diversité génétique et sa capacité à répondre à de nouvelles conditions climatiques. Une place au soleil Dès sa germination, la tige du chêne cherche à s’élever vers le haut. Son élan vital la pousse à rechercher le maximum de lumière et il en sera ainsi durant toute la vie de l’arbre. De par l’existence d’un tronc, structure rigide par excellence, l’arbre a la capacité de se dresser au-dessus de toutes les autres plantes et de les dominer. Il possède donc un avantage certain dans cette course pour une place au soleil. Destinée, Destinée ! Toutefois, selon l’environnement dans lequel il a vu le jour, le chêne ne se développera pas de la même manière. Même s’il existe un déterminisme génétique propre à chaque espèce, lequel conditionne sa croissance, le chêne doit faire avec son environnement. Pour un chêne, germer et grandir en forêt, dans le bocage ou ailleurs n’implique pas le même devenir. En forêt publique ou privée, sa destinée est, le plus souvent, celle d’un arbre de production. Il lui faut s’élever longuement vers le ciel, le plus droit possible de surcroit, et ne pas disperser son énergie à la fabrication de branches inutiles. La technique de la sylviculture se charge de donner à ce fleuron de la foresterie française, l’allure qui sied. Tout au long de la croissance de l’arbre, les forestiers veillent à favoriser le développement des petits chênes en pratiquant des éclaircies tous les 8-10 ans. Le sous-étage - charmes, hêtres - est conservé car il apporte l’ombre nécessaire au tronc du chêne. À l’âge de 50 ans environ, les chênes d’avenir sont repérés et leur développement favorisé. Au fil du temps, le chêne va adopter le port caractéristique que nous connaissons dans les futaies destinées à la production de bois d’œuvre : tronc démesuré et houppier étriqué. En milieu ouvert, la concurrence pour la lumière n’étant pas à l’ordre du jour, le chêne se développe à son aise. Nul besoin de fabriquer un tronc gigantesque, une solide assise suffit. Par contre, la ramure peut prendre toute son ampleur, se ramifier à 360° et s’étoffer avec des branches charpentières et des branches secondaires. La silhouette signe l'âge du chêne Outre l’apparence de l’arbre, l’âge est un autre critère déterminant. Un chêne jeune ne portera pas son houppier comme un chêne adulte ou un chêne mature. Dans sa jeunesse, il arbore des branches fines et un houppier de forme conique. À l’âge adulte, le houppier s’arrondit. Les branches constituées de fourches successives se terminent par des axes caractéristiques, rectilignes pouvant mesurer un mètre de long. La ramification s’amplifie et le houppier se densifie. Au fil des décennies, la ramure poursuit son développement. Lorsque le chêne arrive à maturité, le houppier n’augmente plus. Les grosses branches ploient sous leur poids et se courbent. Cette tendance s’observe surtout sur les charpentières les plus basses. Petit à petit, la cime s’affaisse aussi et l’arbre présente un houppier irrégulier à l’image d’un chou-fleur. Quelle trogne ! Les chênes de cette nature sont le plus souvent des arbres exploités en têtard par l’homme depuis des siècles. En coupant le tronc et les branches maîtresses à un niveau plus ou moins élevé, on provoque le développement de rejets qui sont récoltés à intervalles réguliers. Ce traitement provoque un gonflement du tronc formé par les cicatrisations successives au même niveau. D’où le nom de trogne. Le chêne hors forêt Pour le tout à chacun et surtout pour le forestier, la valorisation économique du chêne consiste à la commercialisation de son bois. Toute l’organisation de la production tend vers cette finalité. Au cours des dernières décennies, des considérations liées à la préservation de la biodiversité et à la question du changement climatique amènent à reconsidérer le rôle de l’arbre, notamment l’arbre non forestier. |
|||||||||||||||||||
| .. Chêne pédonculé versus chêne sessile Parmi les espèces du groupe des chênes blancs, celles du chêne pédonculé et sessile sont les plus importantes, tant du point de vue économique qu’écologique. Ces deux chênes ont une aire de répartition très vaste allant du nord de l'Espagne au sud de la Scandinavie, et de l’Irlande à l’Europe orientale. Celle du chêne sessile est incluse dans celle du chêne pédonculé, mais se limite à la partie occidentale de l'Ukraine, alors que celle du pédonculé s'étend jusqu'à l'Oural. Ils sont présents dans les plaines, sur la plupart des types de sol, à partir du niveau de la mer jusqu'à 1800 m d'altitude. L'hybridation naturelle des chênes a été rapportée dans de nombreuses études. Le chêne sessile pollinise plus souvent le chêne pédonculé que l’inverse. Cette situation favorise la succession des espèces : le chêne pédonculé, espèce pionnière, est remplacé par le chêne sessile, espèce post-pionnière. Bien qu’il préfère les sols fertiles et bien alimentés en eau, le chêne pédonculé est très tolérant aux conditions de sol et de climat continental. Il supporte même une inondation. Le chêne sessile a, quant à lui, une niche écologique plus large que son cousin poussant sur des sols au pH allant de 3,5 à 9. Il tolère mieux la sécheresse et les sols pauvres que le chêne pédonculé, mais n’apprécie guère les sols gorgés d’eau. Dans les plaines, les plateaux et les collines, le chêne pédonculé est une espèce pionnière et le sessile une espèce plus tardive dans la succession. Si les étés sont secs, le chêne sessile est le stade ultime de la dynamique de la végétation. Dans les vallées et les zones inondables, le chêne pédonculé est une espèce de fin de succession avec les frênes, les grands érables et les ormes. ... |
||||||||||||||||||||

 Les
2 photos : © 2022 – Camera One – Winds –
Gaumont
Les
2 photos : © 2022 – Camera One – Winds –
Gaumont
Le chêne : Nom : Chêne pédonculé - Nom latin : Quercus robur - Né en 1810 à Bracieux Poids : 9 tonnes - Hauteur : 17.5 m - Diamètre : 112 cm - Volume : 11 m |
||||||||||||||||||||
| .. Une vie de chêne Qu’est le temps d’une vie humaine au regard de celui d’un arbre comme le chêne ? Si
l’on considère que 80 ans est la moyenne de l’espérance
de vie à la naissance d’un habitant de l’Europe
occidentale, un chêne de cet âge a encore un très
long avenir devant lui. |
||||||||||||||||||||

 Les 2 photos : © 2022 – Camera One – Winds – Gaumont |
||||||||||||||||||||
| Pour
un chêne, germer et grandir en forêt, dans le bocage
ou ailleurs, n’implique pas le même devenir. ..... |
||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||


 Les
3 photos : © 2022 – Camera One – Winds –
Gaumont
Les
3 photos : © 2022 – Camera One – Winds –
Gaumont