|
Ces
milieux naturels originaux, qui concernent plusieurs habitats d’intérêt
communautaire, sont diversifiés sur le territoire francilien,
représentés au sein de nombreux sites Natura 2000 et sujet
à de nombreuses interrogations, tant dans leur caractérisation
que du point
de vue de leur gestion. Ce document vise à dresser un état
des lieux des landes de la Région. Il permet d’appréhender
la diversité des végétations de lande, et constitue
une base de réflexion en vue de définir une stratégie
régionale de conservation cohérente de
ces habitats ayant pour finalité la préservation des landes
du territoire d’étude dans toute leur diversité.
| La
notion de lande
- Conditions
stationnelles |


 Lande
broussailleuse - ©
J. WEGNEZ © CBNBP/MNHN
Lande
broussailleuse - ©
J. WEGNEZ © CBNBP/MNHN

|
La
notion de lande
Le
terme de lande est issu du celte landa qui signifie
terre couverte... de plantes sauvages. Il désigne
donc un espace géographique constitué par des étendues
de terres où ne croissent que certaines plantes sauvages
telles les Ajoncs, Bruyères, Genêts... (Petit
Robert). Ce terme fait référence, sous cette vision,
à un type d’occupation du sol correspondant à
des terres incultes car peu fertiles et par conséquent
délaissées durablement ou périodiquement
de toute mise en culture, laissant place au développement
d’espèces sauvages. Sous cette définition
large, ce terme a été largement utilisé pour
qualifier des milieux naturels très divers tant dans leurs
structures que dans leurs compositions floristiques. On parle
ainsi communément de lande à fougères,
de lande à genêt, de lande broussailleuse
- garrigues -, ou de lande à bruyères.
Lande
à bruyères - ©
J. WEGNEZ © CBNBP/MNHN
D’un point de vue scientifique ce terme est beaucoup plus
restrictif. Il correspond à un habitat naturel ou une formation
végétale qui présente, de fait, une physionomie
et une composition floristique bien précise. Les phytosociologues
désignent ainsi communément les landes comme une
végétation ligneuse basse des terrains pauvres à
dominante acide dont la structure est caractérisée
par l’abondance de sous-arbrisseaux - chaméphytes
- et d’arbrisseaux - nanophanérophytes pro parte
- appartenant essentiellement aux familles des Éricacées
- Callune, Bruyère cendrée, Bruyère à
quatre angles... - et des Fabacées : Ajonc nain, Ajonc
d’Europe, Genêt poilu, Genêt Anglais, Genêt
à balais...
Ce
sont sous ces termes que les landes sont étudiées
dans cette étude. Les autres types de landes,
précédemment citées - particulièrement
les landes à fougères qui sont des ourlets en nappe
des clairières et les landes à Genêt qui sont
des pré-manteaux - sont de fait exclus de cette vision.
Conjointement,
certains faciès de pelouses calcicoles, qualifiées
par certains de landines peuvent être dominées
par un arbrisseau de la famille des Cistacées : l’Hélianthéme
jaune (Helianthemum nummularium). Ces végétations,
qui présentent une structure proche aux landes proprement
dites ne doivent pas être confondues avec ces dernières.
Lande
à fougères - ©
J. WEGNEZ © CBNBP/MNHN
Conditions
stationnelles
Les
landes sont des végétations à flore très
spécialisée, inféodées à des
substrats pauvres en nutriments - oligotrophes - et souvent acides.
La teneur en eau du sol ne contraint pas leur développement
mais constitue l’un des paramètres majeurs de leur
déterminisme. Ces caractéristiques édaphiques
résultent de :
- La
nature de la couche superficielle du sol : elle est presque
systématiquement de type siliceux : grès, sables
ou cailloutis. Ces sables peuvent être de nature et
d’origine diverses. Ils peuvent être fins - sables
stampiens par exemple -, ou grossiers lorsqu’ils sont
d’origine alluviale : cailloutis de Sénart ou
sables de Lozère par exemple. La fraction argileuse
du sol est très variable, et parfois importante. Il
peut également comporter occasionnellement des graviers
et des limons. La teneur de ces différents éléments
conditionne en grande partie la disponibilité en eau
du sol. Localement, les landes peuvent également se
développer sur des substrats organiques.
- La
présence à faible profondeur, d’une assise
inférieure : la couche superficielle du sol peut reposer
sur des substrats divers. Elle peut influencer fortement,
suivant sa profondeur et sa nature, plusieurs paramètres
environnementaux et de fait, le type de lande qui se développe
en surface. Ainsi, la présence d’une assise argileuse
influencera le niveau hydrique du sol - formation possible
d’une nappe perchée - quand une assise calcaire,
jouera davantage sur le pH.
- Le
type de sol en place : Sur des sols superficiels - dalles
gréseuses -, les sols sont systématiquement
des rankosols. Sur des sols plus profonds, ceux-ci sont le
plus souvent très lessivés, voire podzoliques
ou podzolisés. Ils peuvent présenter des traces
d’hydromophie plus ou moins profondes et former des
horizons réductiques ou rédoxiques en fonction
de la durée d’engorgement du sol. L’humus,
est le plus souvent un mor ou un anmoor lié à
la faible activité biologique de l’humus due
à son acididté. La disponibilité en nutriments
est de fait extrêmement faible (très faible minéralisation).
Il est également avéré que la disponibilité
en phosphore dans le sol est l’un des principaux facteurs
limitant des espèces végétales au sein
des landes. Elle est considérée 30 fois plus
faible que dans un sol brun forestier.
Les
bruyères sont particulièrement bien adaptées
à ces fortes contraintes environnementales grâce
à leur système racinaire important et à leur
symbiose mycorhizienne. De plus, la fréquente nature sableuse
du substrat peut engendrer des contraintes hydriques très
prononcées. Les sous-arbrisseaux landicoles ont la particularité
de posséder des feuilles persistantes, étroites
et à paroi épaisse - feuilles sclérophylles
- particulièrement adaptées au stress hydrique.
L’ensemble de ces caractéristiques rend de fait les
espèces landicoles bien adaptées à cet environnement
très contraignant.
Tout
type de position topographique peut être occupé par
des landes dès lors que les conditions édaphiques
leurs correspondent. On retrouve ainsi des landes, autant sur
plaine ou plateau, que sur versants, vallons et vallées
- sèches principalement - voire au sein de certaines cuvettes
naturelles ou artificielles.
Landines
- ©
J. WEGNEZ © CBNBP/MNHN
Les
landes sont indéniablement associées aux substrats
siliceux ou à fraction sableuse. L’Île-de-France,
située au cœur du bassin tertiaire parisien, possède
un nombre important de terrains sédimentaires sableux :
sables de Fontainebleau en place ou soufflés,
sables des terrasses alluviales du couloir séquanien ou
de la Loire, sables de Lozère. La région
francilienne constitue de fait un territoire très favorable
à l’expression des milieux landicoles. |
| Origine
et dynamique évolutive des landes |
Petite
histoire des landes
Les
landes non littorales et non montagnardes peuvent être,
sur les substrats les plus squelettiques, d’origine primaire,
donc non issue de la main de l’homme. Ces cas de figure
se restreindraient, dans la région, à certains chaos
de grès voire à certaines platières. Cette
origine n’explique donc qu’une part infime de la formation
des landes franciliennes.
Dans les autres contextes, les landes franciliennes sont anthropogènes
et résultent des défrichements intenses exercés
depuis
le néolithique dans les forêts originelles qui ont
été suivis par un usage agraire plus ou moins intensif.
Les landes sont donc considérées généralement
comme des végétations d’origine régressive,
dites secondaires. Ce processus de formation de lande
est extrêmement lent car il impose un appauvrissement considérable
du sol forestier en place. Ce phénomène, dit de
podzolisation, s’opère sous l’effet conjugué
d’une exploitation récurrente et brutale de la végétation
et de l’entraînement en profondeur, par les eaux météoriques,
de la matière organique. Ces modifications profondes des
caractéristiques originelles des sols forestiers, une fois
opérée, ne permettent plus la reconstitution de
la forêt originelle ; la lande s’installe alors de
manière plus ou moins pérenne.
Les données bibliographiques relatives à l’usage
des systèmes landicoles par l’homme sont peu nombreuses
sur le territoire francilien mais il est fort probable qu’elles
étaient vouées à des pratiques analogues
à celles avérées dans d’autres régions
limitrophes. Pendant très longtemps les landes ont ainsi
été intégrées dans l'économie
rurale car elles représentaient la possibilité d'élever
du bétail. Certaines œuvres d’artistes de l’école
de Barbizon témoignent de ces pratiques sur le massif de
Fontainebleau au cours du XIXème siècle (Figures
ci-contre). La vocation pastorale de ces étendues est attestée
en Île-de-France jusqu’au milieu du XXème siècle.
Des droits de pacages étaient ainsi délivrés
sur demande. Les traces physiques de cet usage pastoral passé
sont rares. Plusieurs indices peuvent néanmoins témoigner
de cette pratique historique :
-
la présence ponctuelle de dépressions de forme
géométrique au sein de certains systèmes
landicoles constituerait ainsi des témoins d’anciens
abreuvoirs façonnés par l’homme tel qu’au
Carrefour des bruyères de Neuville à Gambaiseuil.
-
la présence, parfois abondante du Genévrier commun
(Juniperus communis), en particulier dans des localités
où les conditions écologiques ne lui sont pas
favorables ; exemple : les Petites Ventes à
Rambouillet.
-
la présence de Chênes à branches basses
qui témoignent de l’existence passée d’un
environnement plus ouvert.
Exemple
de pastoralisme en forêt de Fontainebleau
immortalisé par quelques peintres de l’école
de Barbizon.
La
mise en culture périodique de ces landes est également
fortement suspectée sur le territoire francilien,
en particulier sur certaines plaines et plateaux tels que dans
la boucle de Moisson. La pauvreté des sols ne permet cependant
pas une mise en culture pérenne et les parcelles étaient
donc rapidement abandonnées ou laissées en pâture.
Néanmoins, la remise en culture temporaire de ces terres
pouvait être, à plus ou moins long terme envisageable
:
-
Après un enrichissement du sol par certaines Fabacées
fixatrices d’azote atmosphérique, localement dynamiques
: Genêt à balais et/ou Ajonc d’Europe,
-
Après brûlage de ces landes - écobuage -
qui permettait également un enrichissement temporaire
du sol.
Lande
pionnière en cours de formation : Domaine présidentiel
– Rambouillet (78)
© J. WEGNEZ © CBNBP/MNHN
Ainsi,
les landes franciliennes ont localement joué un rôle
important dans l’économie agraire de la région
au même titre que les landes littorales. D’autres
ressources pouvaient également être tirées
de ces systèmes landicoles et contribuaient donc à
leur entretien ou leur régénération :
-
L’exploitation des Callunes comme balais ou palissade,
-
L’exploitation des recrus de bouleau comme piquet ou bois
de chauffe,
-
L’exploitation des Ajoncs d’Europe comme fourrage,
-
L’exploitation de la Fougère aigle ou des bruyères
comme litière pour les bêtes ou paillage,
-
L’exploitation de l’humus par étrépage.
Aussi,
les landes franciliennes résultent en grande partie d’une
action anthropique très ancienne. Celles-ci n’atteignirent
leur apogée et leur caractère de massif qu'au Moyen
Âge, caractère qu’elles ont conservé
jusqu’à la fin du XIXème siècle. Les
landes ont ainsi occupé une place importante, tant dans
l’économie rurale que dans les paysages franciliens
comme en témoigne la toponymie récurrente de certains
lieux-dits ou de communes :
-
Communes : Bruyères-le-Châtel (91) et
Bruyères-sur-Oise (95)
-
Lieux dits récurrents évoquant les landes
ou un usage évoquant leur exploitation : Buttes
rouges, Les Bruyères, Les landes, Route des bruyères,
Les brûlis, Les brûlins, La butte brulée,
Bois brulé, Saint-Rémy-les-landes, Bois des hautes
bruyères, Les Uselles ou Uzelles : pâturage appartenant
à une communauté d'habitants au Moyen Âge...
Lande
dans son début de phase d’édification : Petit
Mont-Chauvet – Fontainebleau (77)
© J. WEGNEZ © CBNBP/MNHN
Il
est à noter que nombre de ces dénominations ne trouvent
plus de sens à présent, les landes ayant totalement
disparu de certaines des localités ainsi dénommées.
Au
regard de ces éléments, les landes ont existé
sur le territoire francilien, bien avant l’intervention
de l’homme. Ces dernières devaient néanmoins
être relativement rares, restreintes à certains contextes
particuliers et localement favorisées par les grands herbivores
sauvages historiquement présents dans la région.
L’homme reste néanmoins le principal responsable
de leur expression et a su tirer profit de ces espaces considérés
incultes jusqu’au début du XXème
siècle.
Dynamique
évolutive
Devant la diversité des types de landes de notre Région,
il est difficile de dresser une image globale et fidèle
de leur dynamique évolutive. Néanmoins, elles présentent,
dans leur majorité, des caractéristiques communes
qui permettent de décrire de manière très
schématique leur évolution, tant progressive que
régressive même si la dynamique, la genèse
et l’évolution des landes ne sont pas faciles à
cerner.
Lande
mature : Vallée-Chaude – Noisy-sur-École (77)
© J. WEGNEZ © CBNBP/MNHN
Quel
que soit leurs origines, primaire ou secondaire, les landes franciliennes
tendent toutes à évoluer progressivement vers un
état boisé, stade ultime de leur évolution.
La trajectoire et la vitesse évolutive de cette dynamique
sont variables en fonction de l‘historique de la lande et/ou
du contexte dans lequel elle s’implante. Nous pouvons considérer
schématiquement, trois types de cas
très différents :
- Type
1 : Les landes très anciennes, issues d’un entretien
de longue date : elles sont souvent considérées
comme très stables
-
Type 2 : Les landes restaurées, issues d’un état
boisé immature - boulaie principalement -, qui retrouvent
leur état boisé rapidement par rejet de souche
-
Type 3 : Les landes instables qui succèdent de manière
transitoire à la forêt détruite dans les
clairières et préparent son retour. Au bout de
cinq à dix ans les recrus forestiers dominent et les
espèces landicoles disparaissent peu à peu. Nous
nous bornerons ci-dessous à la description de la dynamique
des landes du premier type.
Lande
dégénérative : Forêt de la Commanderie
– Grez-sur-Loing (77)
© J. WEGNEZ © CBNBP/MNHN
Dynamique
progressive
La
dynamique d’une lande est étroitement corrélée
à l’une des espèces caractéristiques
et quasi systématique des landes, la Callune (Calluna
vulgaris). Suivant son port et son recouvrement, quatre phases
évolutives ont été identifiées :
-
Phase pionnière (0 à 6 ans): La lande se forme,
elle est basse et se compose d’une mosaïque d’Éricacées
et de plages herbacées ou décapées, parfois
dominantes. Elle résulte d’une mise à nu
du sol engendré par des travaux sylvicoles, un étrepage
ou un abroutissement extrême exercé par les lapins.
La diversité floristique est forte et la Bruyère
cendrée (Erica cinerea) ou à quatre angles
(Erica tetralix) peuvent dominer le milieu.
-
Phase édificatrice (6 à 16 ans) : la Callune prend
une forme de coupole fermée haute d’une cinquantaine
de centimètre maximum. Les Éricacées tendent
à recouvrir l’intégralité du sol
dans les stades ultimes, faisant disparaître progressivement
les espèces graminéennes. La Callune est systématiquement
l’espèce dominante et supplante les autres sous-arbrisseaux.
Le cortège floristique s’appauvrit considérablement.
-
Phase mature (15 à 25 ans): La Callune ne croit plus
en hauteur, elle peut atteindre plus d’un mètre
de hauteur et commence à présenter des signes
de dépérissement. La partie centrale s’ouvre,
ses rameaux commencent progressivement à s’affaisser
et la strate bryolichénique se densifie pour former un
feutrage. Les bruyères (Erica cinerea et/ou
Erica tetralix) tendent à disparaître.
Le cortège floristique est extrêmement pauvre et
la lande présente une physionomie relativement homogène.
-
Phase dégénérative (25 à 35 ans)
: la lande dépérit. Les pieds de Callune présentent
des couronnes discontinues de rameaux dressés aux extrémités
et des tiges enfouies dans les mousses et dans l’humus
où elles sont ancrées par d’abondantes racines
adventives. Les espèces arbustives et/ou forestières
se diversifient et annoncent l’implantation prochaine
d’un fourré et/ou de la forêt.
Aspect
de la Callune lors de la phase dégénérative
: Golf de Mortefontaine (60)
© J. WEGNEZ © CBNBP/MNHN
Au
cours de cette série théorique, le cortège
floristique évolue de manière significative. Les
landes rases à Erica cinerea ou Erica tetralix
traduisent un stade pionnier tandis que les phases mûres
prennent l'aspect de Callunaies.
Cette
série dynamique reste assez théorique. On constate
en effet une colonisation arborée souvent précoce,
principalement sur les zones de contact ou à proximité
de la lisière forestière. On parle d’effet
de bordure. Cette dynamique pré-sylvatique est d’autant
plus forte si des porte-graines d’essences pionnières
anémochores, tels les pins ou les bouleaux, sont à
proximité.
Suivant le type de lande et/ou son contexte environnemental, les
landes peuvent, en absence d’intervention humaine, prendre
plusieurs trajectoires évolutives avant le retour à
la forêt. Elles peuvent ainsi former :
-
un fourré lorsque les espèces arbustives dominent.
Le développement de Fabacées - Ajonc d’Europe
et/ou Genêt à balais - est relativement fréquent
et favorise un enrichissement progressif du sol par fixation
de l’azote atmosphérique.
-
un pré-bois landicole qui peut persister pendant de très
nombreuses années en fonction de la dynamique arborée
et de l’espèce dominante. La densification du couvert
engendre néanmoins une fragmentation de la lande qui
disparaît progressivement. Cette trajectoire évolutive
est la plus fréquente sur le territoire francilien.
-
un ourlet à Fougère aigle - Ptéridaie -
par colonisation progressive d’un foyer connexe ou sous
l’effet d’une perturbation : incendie, passage d’engins...
Colonisation
progressive d’une lande sèche par les bouleaux et
la Fougère aigle
© J. WEGNEZ © CBNBP/MNHN
Le
développement de ces espèces - mis à part
celle des pins - favorise progressivement la reconstitution d’un
sol brun au-dessus des horizons podzolisés, ce qui rend
la restauration des landes plus aléatoire ou moins pérenne.
Dynamique
régressive ou anthropogène
Différentes
pressions ou perturbations peuvent conduire à d’autres
trajectoires évolutives que celles précédemment
présentées. Elles sont d’origine anthropique
ou naturelle et conduisent à l’entretien de la lande,
sa régénération ou sa dégradation,
réversible ou non.
Les
facteurs principaux identifiés sont :
-
Le
feu : Nous pouvons supposer qu’il a occupé une
place importante dans la formation et la conservation des
landes. Nombre de lieux-dits peuvent témoigner ainsi
de pratiques ancestrales d’écobuages - les Brulins,
les brûlis, bois brulé... -, certainement effectuées
afin de fertiliser temporairement les sols avant leur mise
en culture. Ces pratiques existent encore dans de nombreuses
régions du monde. Son impact sur la lande est très
différent en fonction de son intensité et/ou
de sa fréquence. Si le feu n’est pas trop violent,
on assiste à une réduction provisoire du nombre
et de l’importance des Ajoncs et des Bruyères
au bénéfice des herbacées, en particulier
la Molinie, fortement dominante si les feux sont fréquents.
Les incendies violents et répétés sont
catastrophiques. La lande, détruite durablement, fait
place, au sein des landes fraîches à humides,
à une Molinaie pure dans laquelle le bouleau s’installe
facilement. Le Genêt à balais et/ou la Fougère
aigle peuvent également être très dynamiques
et se substituer définitivement à la lande.
La résilience des landes après incendie est
donc très différente en fonction des caractéristiques
du feu : feu courant, feu d’humus, périodicité...
-
L’action
des lapins : Les lapins sont des habitants récurrents
des systèmes landicoles. Ils jouaient, avant la venue
de la myxomatose, un rôle central dans la régénération
et le maintien de ces systèmes par pression d’herbivorie.
Ils favorisent l’émergence de sols nus, le développement
d’espèces herbacées - vivaces ou pérennes
- et la constitution de complexes de végétations
- pelouse/lande - propices à l’expression d’une
riche biodiversité.
-
Le
pâturage : Le pâturage a un impact sur la lande,
tant par abroutissement que par piétinement. Les effets
respectifs de ces deux paramètres sont difficiles à
dissocier. Suivant son intensité, le pâturage
a un impact plus ou moins fort sur la lande. Extensif, il
favorise son maintien. Son intensification favorise les espèces
herbacées et la constitution de landes herbeuses
: mosaïque de landes et de pelouses. En cas de pression
trop forte, la lande peut disparaître de manière
plus ou moins durable au profit d’une pelouse. Un piétinement
excessif, lié à une affluence touristique par
exemple, conduit à un impact relativement semblable.
-
L’étrépage
: dans certaines régions, l’étrépage
était une pratique courante au sein des systèmes
landicoles. Il a pour effet de régénérer
la lande en passant de manière plus ou moins durable,
par un stade de pelouse. Ce rajeunissement ou décapage
du substrat peut également être généré
lors d’une exploitation sylvicole, en particulier sur
des sols très sableux.
-
L’enrésinement
: la plantation de Pin au sein des landes fraîches ou
humides, a un impact relativement similaire aux feux intenses
et/ou répété. On constate une substitution
progressive des espèces arbustives au profit de la
Molinie. Une molinaie pure peut ainsi se substituer de manière
durable à la lande, y compris après exploitation
des résineux.
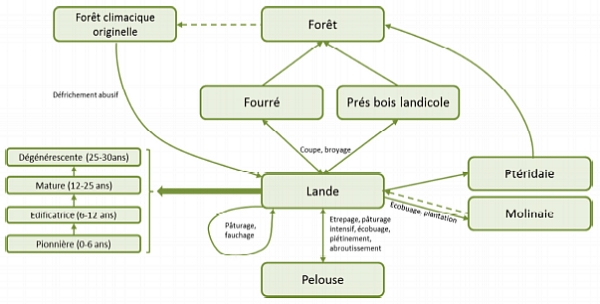 Schématisation
de la dynamique des landes non tourbeuses de la région
francilienne. Les informations spécifiées concernent
avant tout les facteurs potentiels de dynamique régressive. Schématisation
de la dynamique des landes non tourbeuses de la région
francilienne. Les informations spécifiées concernent
avant tout les facteurs potentiels de dynamique régressive.
© J. WEGNEZ © CBNBP/MNHN
|
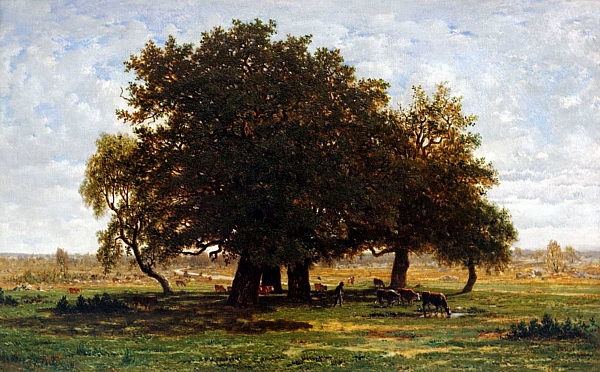
Théodore
Rousseau - Les Chênes d'Apremont, vers 1850

Jean-Baptiste
Camille Corot - Le Rageur, vers 1830






 Colonisation progressive d’une lande sèche
par le Genêt à balais - ©
J. WEGNEZ © CBNBP/MNHN
Colonisation progressive d’une lande sèche
par le Genêt à balais - ©
J. WEGNEZ © CBNBP/MNHN

Remise à nu d’un sol après exploitation sylvicole
permettant une reconquête progressive de la lande : Les
Béorlots ; Fontainebleau - ©
J. WEGNEZ © CBNBP/MNHN

Lande dégradée à Molinie résultant
certainement d’incendies ancien ou d’un enrésinnement
(Saint-Léger-en-Yvelines) - ©
J. WEGNEZ © CBNBP/MNHN
|
Conservatoire
botanique national du Bassin parisien
Unité Inventaire et suivi de la biodiversité
- Muséum national d’Histoire naturelle |
| Le
Conservatoire botanique national du Bassin parisien, un service
scientifique du Muséum national d'Histoire naturelle, a
quatre missions :
- Une
mission de connaissance de l’état et de l’évolution
de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels.
À ce titre, il réalise un inventaire de la flore
- non seulement les espèces protégées,
mais aussi la flore ordinaire - et un inventaire des
végétations.
- Une
mission de conservation des espèces les plus menacées.
Les espèces particulièrement en danger font ensuite
l'objet d'une conservation in situ - propositions de mesures
de gestion - et ex situ : constitution d'une banque de gènes.
- Une
mission d’assistance technique et scientifique auprès
de l’Etat, de ses établissements publics, des collectivités
territoriales et de leurs groupements, en matière de
flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels.
- Une
mission d’information et d’éducation du public
à la connaissance et à la préservation
de la diversité végétale.
Cette mission s'exerce suivant quatre axes :
- publications
scientifiques,
- muséologie
et sensibilisation du public,
- expertises,
- enseignement
et vie universitaire.
Le Conservatoire botanique développe donc deux types d'activités
: les unes en relation avec le Ministère en charge de l'Écologie
et du Développement Durable et les autres en relation avec
le Ministère en charge de l'Enseignement supérieur
et de la recherche.
Les
activités en liaison avec le Ministère en charge
de l'Écologie et du Développement Durable concernent
:
- les
inventaires de terrain,
- la
gestion d'une base de données factuelles liée
à un Système d'Informations Géographique,
- la
mise au point de mesures de gestion des espèces les plus
menacées in situ,
- la
constitution de collections de sauvegarde : banques de gènes,
- l'organisation
de l'information sur les espèces en voie de disparition.
Les
activités en liaison avec le Ministère en charge
de l'Enseignement supérieur et de la recherche sont complémentaires
des précédentes. Elles portent sur la Biologie de
la conservation :
- étude
de l'évolution des espèces à faibles nombres
de populations et/ou faibles effectifs,
- stratégies
associées de gestion : renforcements des populations,
réintroductions d'espèces et conservation des
milieux.
Au
plan régional, le Conservatoire est inséré
dans le réseau des structures liées à la
conservation de la nature par des conventions qu'il a tissées
avec :
- des
établissements publics,
- des
collectivités et agences territoriales,
- des
parcs naturels régionaux,
- des
Conservatoires des sites,
- des
bureaux d'études.
Au
plan national, depuis le 1er janvier 2017, l'Agence
française pour la biodiversité assure la coordination
technique des Conservatoires botaniques nationaux.
Au
plan international, le Conservatoire botanique national du Bassin
parisien est appelé à jouer un rôle certain
dans les grands programmes internationaux de conservation du patrimoine
végétal de par la position de référence
que souhaite voir jouer le Muséum et de par ses
liens avec les autres grands centres de conservation étrangers.
|
. Étude
Les landes d’Île-de-France
Étude
Les landes d’Île-de-France
|
|
cbnbp.mnhn.fr
|
|
Ce document a été réalisé
par le Conservatoire botanique national du Bassin parisien,
délégation Île-de-France.
Sous la responsabilité de :
Frédéric
Hendoux, directeur du CBNBP ; Jeanne Vallet, Responsable
de la délégation Île-de-France
Auteur
du rapport : Jérôme Wegnez, CBNBP, délégation
Île-de-France, septembre 2016
Inventaires de terrain : Jérôme Wegnez,
Thierry Fernez et Leslie Ferreira
Cartographie : Jérôme Wegnez.
Gestion des données, analyses : Jérôme
Wegnez, Thierry Fernez et Gaël Causse
Relecture : Thierry Fernez, Gaël Causse et
Jeanne Vallet
Saisie des données : Jérôme
Wegnez et Thierry Fernez
Le partenaire de cette étude est :
Direction régionale et interdépartementale
de l’environnement et de l’énergie d’Île-de-France
(DRIEE-IF)
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() Étude
Les landes d’Île-de-France
Étude
Les landes d’Île-de-France

 Lande
broussailleuse - ©
J. WEGNEZ © CBNBP/MNHN
Lande
broussailleuse - ©
J. WEGNEZ © CBNBP/MNHN
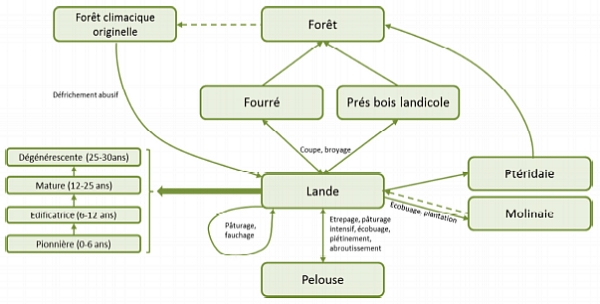 Schématisation
de la dynamique des landes non tourbeuses de la région
francilienne. Les informations spécifiées concernent
avant tout les facteurs potentiels de dynamique régressive.
Schématisation
de la dynamique des landes non tourbeuses de la région
francilienne. Les informations spécifiées concernent
avant tout les facteurs potentiels de dynamique régressive.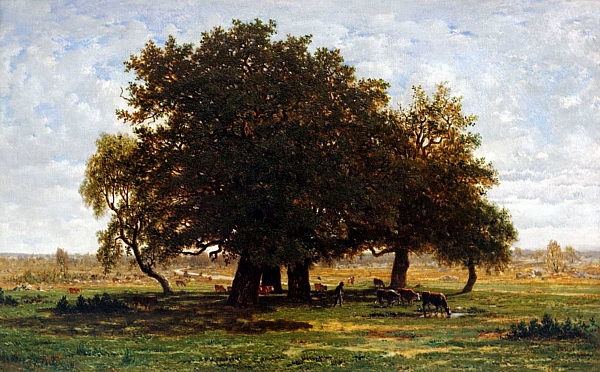







 Colonisation progressive d’une lande sèche
par le Genêt à balais - ©
J. WEGNEZ © CBNBP/MNHN
Colonisation progressive d’une lande sèche
par le Genêt à balais - ©
J. WEGNEZ © CBNBP/MNHN

