![]() La
vie secrète des plantes et des animaux
La
vie secrète des plantes et des animaux
(2)
La vie secrète des plantes
Plantes, animaux, microbes : des mondes en interaction
Les plantes sont des organismes fascinants. L’analyse génomique
permet de mieux les appréhender, mais elles demeurent encore étonnamment
secrètes. Il faut bien entendu se garder de tout anthropomorphisme
lorsqu’on les évoque, mais avouons que les termes qu’emploient
certains chercheurs pour les décrire ne nous y aident guère.
Ainsi, les plantes dialoguent et interagissent avec leurs voisines, les
insectes ou les organismes symbiotiques ; elles perçoivent la position
de leur corps dans l’espace et voient même ce qui se passe
autour d’elles. Dans la nature, tout le monde se parle, s’entraide
ou s’affronte. La connaissance de ces interactions est essentielle
pour favoriser celles qui sont bénéfiques aux plantes et
aux animaux qui nous sont nécessaires et pour limiter l’impact
des autres.
|
La
vie secrète des plantes |
||||||||||
|
La graine, un système d'une rare complexité À l’Inra, le laboratoire reproduction et développement des plantes s’intéresse à la façon dont les plantes se forment et se développent. Les chercheurs étudient notamment la formations des graines et les interactions moléculaires, hormonales et génétiques, qu’entretiennent les trois compartiments de la graine. Et si les connaissances progressent, bien des secrets restent à découvrir, tant ce petit organisme se révèle complexe... et surprenant. Ainsi, contrairement aux animaux, la graine est le produit d’une double fécondation. Lorsque le grain de pollen - mâle - descend le long du pistil, la cellule reproductrice qu’il contient se divise en deux cellules spermatiques : cellule reproductrice mâle. L’une va fusionner avec une première cellule reproductrice femelle, et donner naissance à l’embryon, tandis que l’autre fusionnera avec une seconde cellule reproductrice femelle pour constituer l’albumen. Pour se développer, l’embryon va ensuite dévorer petit à petit l’albumen qui constitue un réservoir de substances nutritives. Albumen qui, rappelons-le, provient de l’une des deux cellules spermatiques. Oui, l’embryon dévore son petit frère ! Mais suivant les plantes, le processus prend plus ou moins de temps. Ainsi, si vous pressez un grain de maïs, vous y trouverez un petit point blanc. C’est l’embryon, enveloppé par l’albumen, lui-même enveloppé par le tissu maternel, à la manière des poupées russes. Ce n’est qu’une fois en terre, que l’embryon poursuivra son repas pour puiser l’énergie nécessaire à la germination. À présent, décortiquez un petit pois : vous n’y trouverez que l’embryon qui a déjà consommé tout l’albumen. Deux graines, deux processus différents dans la gestion des ressources nutritives. Vous ne regarderez plus votre plat de lentilles de la même façon ! Les plantes de service, de précieux auxiliaires de culture Les pucerons sont des nez sur pattes ! Leurs récepteurs olfactifs sont capables de reconnaître avec une grande précision les composés volatils émis par leurs plantes préférées. Mais si certaines odeurs les attirent irrésistiblement, d’autres en revanche les font fuir ou perturbent leur comportement. Une sélectivité que les chercheurs s’attachent à mieux comprendre afin de l’exploiter dans une approche de biocontrôle. Notamment en s’appuyant sur les plantes de service. Les jardiniers connaissent de longue date l’action répulsive des œillets d’Inde installés à proximité des pieds de tomates. D’autres végétaux attirent au contraire le ravageur et le détournent de la plante cultivée, qu’il colonise en temps normal. Enfin, certaines plantes attirent les ennemis naturels du puceron et contribuent ainsi à son élimination. Identifier les composés volatils, impliqués dans cette modification du comportement des insectes, est une étape essentielle, préalable à la sélection de plantes de service. Et ça n’a rien d’évident car le puceron est, dans ce domaine, particulièrement tatillon. Il ne suffit pas de lui proposer le mélange d’odeurs auxquelles il paraît sensible pour déclencher une réaction. Encore faut-il les lui présenter dans les bonnes concentrations et proportions. C’est pour cette raison que les chercheurs testent un à un chaque composé volatil afin de trouver la bonne recette du cocktail qui déclenchera, à coup sûr, l’attraction ou la fuite du puceron, selon l’effet recherché. Leur but ultime ? Parvenir à modifier le profil des composés volatils émis par les plantes de service, par exemple en jouant sur le choix du génotype, la fertilisation, ou l’irrigation, de manière à optimiser leur efficacité. Avec toute la prudence qui s’impose, car il n’est pas question de privilégier une plante qui perturberait les auxiliaires de culture présents dans la parcelle, à commencer par les prédateurs naturels des pucerons. Sans oublier que pour s’imposer, ces plantes doivent aussi rester simples à entretenir et ne pas représenter une contrainte supplémentaire pour l’agriculteur. Mais le jeu en vaut la chandelle, tant les plantes de services peuvent constituer une alternative efficace et durable aux produits phytosanitaires. Ce que voient les plantes Les plantes perçoivent les différentes couleurs qui composent la lumière. Non seulement elles les voient mais elles les interprètent et les emploient de manière différenciée, en fonction de besoins qui vont bien au-delà de la seule captation de l’énergie via la photosynthèse. Ainsi, la composition spectrale de la lumière affecte leur croissance, la forme et la taille de leurs ramifications, ou encore la longueur ou l’épaisseur de leurs feuilles. C’est ce que l’on nomme la photomorphogenèse. Mais le plus stupéfiant est à venir. Une plante voit son environnement proche. Vous avez bien lu. Grâce à l’analyse de la composition spectrale de la lumière réfléchie par les formes alentour, elle sait, dès sa sortie de terre, combien de plantes l’entourent et à quelle distance elles se trouvent. Si la compétition pour la lumière s’annonce âpre, elle va modifier son comportement de croissance pour capter le maximum d’énergie et éviter de se retrouver à l’ombre de ses congénères. Afin d’étudier ce comportement, une équipe de l’Inra a développé un dispositif expérimental permettant d’analyser, en conditions réelles, la compétition d’une plante pour la lumière, dans différents types de couverts végétaux et à tous les stades de sa croissance. Ces informations permettront de développer un modèle mathématique capable de simuler les interactions entre végétaux d’une même espèce, ou cultivés en association. Et à terme, d’identifier les individus les mieux adaptés à un type de culture. Par exemple le fourrage, où, en raison de la densité du semis, la compétition s’avère très importante et conduit fréquemment à la disparition d’espèces inadaptées, ou tout au moins à une baisse de la quantité et de la qualité des récoltes. Les plantes interagissent... et c'est formidable Les recherches sur la génétique monopolisent un grand nombre de chercheurs de l’Inra. Mais ce n’est que depuis cinq ans, qu’une équipe étudie spécifiquement les gènes impliqués dans la variation des relations entre les plantes. Objectif de cet ambitieux programme, comprendre les mécanismes moléculaires à l’origine des interactions entre espèces et variétés similaires ou différentes. Et les premières découvertes interrogent autant qu’elles étonnent. Ainsi, les chercheurs ont observé qu’environ 7 % des lignées génétiques d’une même espèce, de la plante modèle Arabidopsis, coopèrent entre elles. Lorsqu’on les plante côte à côte, elles produisent ensemble jusqu’à trois fois plus de biomasse que lorsqu’elles poussent seules, alors que, du fait de leur proximité, elles disposent de moitié moins de ressources. Comment s’opère cette interaction ? Communiquent-elles via des signaux émis par les feuilles ou le réseau racinaire ? C’est un mystère, que les chercheurs vont s’efforcer de résoudre. Parce qu’il n’est pas difficile d’imaginer ce que donneraient ces interactions appliquées à des variétés d’intérêt agronomique ! Une autre découverte concerne cette fois les plantes adventices. Responsables de pertes de rendement supérieures à celles que causent les bactéries, les champignons ou les insectes ravageurs, elles concentrent 70 % des pesticides utilisés en agriculture. Or, en étudiant Arabidopsis, les chercheurs ont découvert des gènes qui permettent aux plantes qui les expriment de produire jusqu’à 50 % de graines en plus en présence d’une espèce adventice, avant que cette dernière ne soit éliminée ! Là encore, on ne sait pas comment ça marche, mais comment ne pas être séduit à la perspective de transformer les adventices en plantes de service ? La proprioception chez les plantes Les plantes perçoivent la forme et la position de leur corps. Cette proprioception a été mise en évidence par des chercheurs de l’Inra au cours d’une étonnante expérience. Ils ont placé de jeunes plantes dans des supports positionnés à l’horizontale et les ont fait tourner sur elles-mêmes dans l’obscurité. Privées de lumière et désorientées par rapport à la gravité, elles ont pourtant conservé une posture droite à mesure de leur croissance. Ce qui signifie qu’elles sont capables de mouvements actifs dans le but d’adopter la forme recherchée, un peu comme un homme qui corrige sa posture en permanence et de manière inconsciente pour conserver sa rectitude. En conditions naturelles, la plante combine proprioception et perception de l’orientation par rapport à la gravité pour contrôler sa posture. C’est cette faculté qui permet au jeune arbre de se redresser après avoir versé à la suite d’une tempête. Une aubaine, car avec les changements climatiques, la fréquence et l’intensité des épisodes extrêmes vont sans doute augmenter. Mais il n’y a pas que les arbres qui vont y être confrontés. Les céréales sont tout aussi exposées. Peut-être avez-vous déjà vu des parties de champs de blés versées à la suite d’un fort coup de vent. Mais saviez-vous que ce phénomène a entraîné une perte de 5 à 10 % des rendements au niveau mondial au cours de ces dix dernières années ? Et pourtant, les céréales sont aujourd’hui bien moins hautes que par le passé. Pourrait-on encore réduire leur taille et donc leur exposition au vent ? Pas sûr, car plus les organes sont proches du sol, plus ils peuvent être éclaboussés par de la terre porteuse d’organismes pathogènes lors de violentes averses. Mais d’autres pistes sont à l’étude. Et notamment, la sélection génétique de variétés capables de percevoir leur exposition au vent et d’adapter leur résistance. Attention, pas question de tenir à tout prix, cela demanderait trop d’énergie que la plante ne consacrerait pas à la production de grains. Non, les chercheurs souhaitent exploiter aussi la proprioception du végétal. En cas de tempête, la plante sacrifiera un fusible, en l’occurrence quelques racines, afin de se laisser tomber, pour se redresser ensuite activement. |
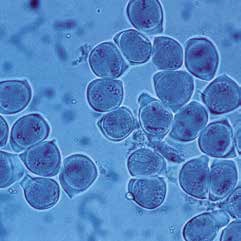

   ©
Photos : Inra/Adobe Stock ©
Photos : Inra/Adobe Stock |
|||||||||
|
Plantes, animaux, microbes : des mondes en interaction |
||||||||||
|
Malin comme un virus Les virus sont des organismes extrêmement simples. Pourtant, quels trésors d’ingéniosité déploient-ils pour se multiplier ! La façon dont ils manipulent les plantes qui les hébergent est si subtile qu’on serait tenté d’y voir une forme d’intelligence. Il n’en est rien évidemment. Pas de cerveau chez les virus, mais une incroyable adaptation au milieu. Qui leur permet notamment de franchir la distance considérable, à leur échelle microscopique, qui les sépare de la prochaine plante hôte. Pour s’y rendre, ils sont contraints d’utiliser un vecteur, un véhicule en quelque sorte. Et il s’agit souvent du puceron. Ces petits insectes phytophages sont un cauchemar pour les agriculteurs et les maraîchers, autant que pour le jardinier amateur. Et pour cause. Non contents d’affaiblir les plantes en aspirant leur sève, ils leur transmettent des virus pathogènes. Et parfois en grand nombre. Ainsi, le puceron Myzus persicae est impliqué dans la transmission de plus de 100 espèces de virus ! Mais comment le microscopique organisme s’y prend-il pour emprunter son moyen de transport ? Eh bien, il commence par l’attirer. On ignore encore précisément comment il s’y prend, et peut-être utilise-t-il plusieurs moyens. Mais déjà, les chercheurs ont découvert que les virus expriment des protéines qui provoquent des symptômes visibles sur les plantes, tels que l’apparition de jaunisses, auxquels les pucerons sont sensibles. Mais il y a plus malin encore. Ils rendent aussi la plante plus appétissante, peut-être en boostant les composés volatils qu’elle émet naturellement et en modifiant son goût, afin que l’insecte consomme assez de sève pour accumuler la charge virale nécessaire à l’infection de la prochaine plante ! Dans le cadre d’un nouveau projet de quatre ans, les chercheurs de l’Inra vont s’attacher à décortiquer les protéines du virus qui rendent la plante plus attractive et plus appétissante pour le puceron. La finalité des recherches consistant à trouver le moyen de bloquer cette transmission. Des travaux qui pourraient permettre aux sélectionneurs de privilégier des variétés de plantes produisant naturellement moins de ces composés bénéfiques à la propagation du virus par le puceron. Associées à des plantes de services attractives, dans une stratégie de contrôle globale, elles seraient alors plus efficacement protégées contre les pucerons et les virus qu’ils véhiculent. Salmonelle, une championne de l'infiltration Les bactéries intracellulaires sont de minuscules organismes pleins de ressources. Ainsi, pour pénétrer à l’intérieur de la cellule de leur hôte, s’y nourrir et s’y multiplier, elles peuvent exploiter deux mécanismes. Certaines utilisent une entrée de type Trigger. À l’aide d’une seringue, elles injectent des molécules provoquant des sortes de renflements de la membrane cellulaire qui finissent par englober totalement la bactérie, conduisant à son internalisation. L’élégance du processus réside dans le fait qu’en agissant ainsi, la bactérie ne fait que détourner à son profit la méthode qu’emploie la cellule pour aller chercher dans le milieu les composants dont elle se nourrit. Le second mécanisme, qu’on nomme entrée de type Zipper, est tout aussi remarquable et n’est pas sans rappeler la backdoor informatique. La bactérie s’agrippe à un récepteur de la membrane extérieure qui est prévu pour être internalisé et faire rentrer des molécules extérieures, dans un processus de communication entre la cellule et son environnement. En l’état des connaissances actuelles, toutes les bactéries intracellulaires n’utilisent que l’un ou l’autre des mécanismes. Sauf salmonelle. On pensait depuis une trentaine d’années que cette bactérie n’exploitait que le Trigger pour pénétrer la cellule et qu’elle se multipliait dans une vacuole, un petit compartiment qu’elle modifie pour survivre et se multiplier. Mais des chercheurs de l’Inra ont découvert que certaines d’entre elles, comme par hasard les plus virulentes pour l’homme, pouvaient également exploiter le mécanisme Zipper. Et très récemment, ils ont montré que salmonelle disposait de nombreuses molécules, dont certaines encore à identifier, capables d’induire ce mécanisme ! Ils s’attachent maintenant à décrire leurs fonctionnements tout en poursuivant l’étude du comportement de la bactérie après son internalisation : comment elle s’installe, se nourrit ou se multiplie... Très récemment, il a été démontré que les salmonelles pouvaient non seulement coloniser une vacuole, mais aussi le cytosol, le liquide où baigne l’essentiel des composants de la cellule. Des connaissances indispensables pour comprendre comment la cellule réagit à l’entrée de la bactérie et quels moyens de défense elle déploie pour éliminer l’intrus. La truffe, précieux champignon symbiotique Les plantes ne vivent pas seules. Leurs racines notamment sont en relation avec des microorganismes, principalement des champignons, dans une association symbiotique qu’on nomme la mycorhize. Le mycélium, l’appareil végétatif du champignon, explore le sol et transmet à la plante l’azote, le phosphore et l’eau dont elle se nourrit. En échange, il reçoit les sucres nécessaires à son développement. On considère qu’entre 80 et 90 % des végétaux vivent en symbiose avec les champignons. Cela fait des années que les pépiniéristes tirent profit de cette franche camaraderie. Ainsi, en associant un champignon au pin Douglas, ils favorisent la croissance de ce dernier. Et en 1972, l’Inra a créé les premiers plants de chênes mycorhizés avec Tuber melanosporum. Eh oui, la truffe du Périgord, ou truffe noire, est un champignon symbiotique dont l’organe reproducteur à la forme globuleuse fait le bonheur des palais délicats, et fortunés. Désormais, les chercheurs s’attachent à mieux comprendre comment s’établit et se maintient la symbiose entre une plante et son champignon. Récemment, ils ont découvert que les deux organismes se parlent. Lors d’expérimentations en laboratoire, ils ont observé que le champignon Laccaria bicolor s’efforce de montrer patte blanche au système racinaire du peuplier auquel il souhaite s’associer, en exprimant une molécule qui témoigne de ses bonnes intentions. La truffe est bien entendu étudiée avec le même intérêt, dans le but d’améliorer sa culture. Parce que si l’on sait depuis près de 50 ans comment créer des chênes truffiers, amener le précieux champignon à maturité est une affaire délicate. Notamment en raison de son mode de développement. Contrairement au cèpe par exemple, la truffe noire se forme dans la terre aux mois de mai-juin et va y demeurer six à huit mois supplémentaires. Durant cette période, le champignon est confronté non seulement aux animaux qui la convoitent, mais aussi aux aléas climatiques. Or, il est particulièrement sensible aux longues périodes de sécheresse. Pour cette raison, les chercheurs, en relation avec les professionnels, étudient dans le cadre du projet Culturtruf, les moyens d’optimiser la gestion de l’eau en truffière. Déjà, des capteurs installés dans le sol ont permis de caractériser la façon dont les meilleurs trufficulteurs gèrent l’irrigation, et ainsi de proposer des recommandations générales pour optimiser les ressources en eau. N’oublions pas que l’essentiel des truffes du Périgord sont en fait cultivées dans le sud-est, où les épisodes caniculaires et les sécheresses tendent à se multiplier ces dernières années. La rouille du peuplier fait fi de toute résistance Tout est affaire de compromis. Plus une plante pousse vite et plus elle est fragile face aux maladies, car elle monopolise une part importante de son énergie pour croître, plutôt que pour se défendre. Prenez un groupe de peupliers sauvages, par exemple. Ces arbres, qui poussent lentement et sont parfois un peu pliés, s’avèrent totalement inadaptés à la production de bois. Mais lorsqu’ils sont confrontés à une épidémie de rouille causée par le champignon Melampsora larici-populina, ils opposent un bon niveau de résistance et les dégâts qu’ils subissent restent modérés. En plus de leur rusticité, c’est leur diversité génétique qui contribue à cette résilience. Au contraire, lorsque ce même champignon frappe une peupleraie, il peut entraîner un déficit de croissance des arbres qui peut atteindre 60 % sur une année. Et cette fois, des centaines ou des milliers d’individus peuvent être affectés, car les arbres d’une peupleraie sont des clones génétiquement identiques. Ces peupliers sont le fruit d’une sélection sévère qui a fait d’eux des champions de la croissance rapide et rectiligne, mais des nains en termes de résistance aux bioagresseurs. Bien sûr, les généticiens s’efforcent de sélectionner des variétés offrant une bonne résistance aux maladies, dont la rouille. Mais le champignon, dont la survie dépend de sa colonisation du peuplier, est capable d’évoluer rapidement pour contourner les défenses mises en place par les sélectionneurs. Admettons qu’il lui faille dix ans pour faire sauter le verrou, il lui en restera au moins autant pour profiter de son hôte devenu accessible. Les chercheurs étudient depuis de nombreuses années ce champignon pathogène. Après avoir séquencé son génome en 2011, ils ont récemment identifié la région qui contient le gène responsable d’une mutation de la virulence. À présent, ils s’efforcent de le caractériser pour comprendre comment le champignon évolue et comment il parvient à contourner la résistance de son hôte. Ces travaux pourraient permettre aux généticiens de créer des variétés offrant une résistance plus durable. Idéalement, une vingtaine d’années, l’âge moyen pour l’abattage d’une peupleraie. Légumineuses et rhizobium : une symbiose mutaliste Les légumineuses constituent une ressource alimentaire aussi bien pour les hommes que pour les animaux. Mais elles sont également précieuses pour l’environnement en raison de leur faculté à fixer l’azote de l’air et à terme, enrichir le sol en azote. À ce titre, elles peuvent être assimilées à de l’engrais vert, ce qui explique leur succès en agriculture biologique. Mais pas seulement. En conventionnel aussi, les légumineuses gagnent du terrain. Cultivées en rotation, ou en association avec d’autres cultures d’intérêt agronomique, elles permettent de réduire l’usage des intrants azotés, coûteux et polluants. Les bénéfices des légumineuses pour la fertilité des sols sont connus depuis l’Antiquité. Pline l’Ancien indique ainsi : Une culture de lupin engraisse les champs et les vignes. Loin d’avoir besoin de fumier, il tient lieu du meilleur engrais. On sait aujourd’hui que ces bienfaits sont dus à la symbiose mutualiste entre les légumineuses et des bactéries du sol nommées rhizobium. Lorsque celles-ci pénètrent dans le système racinaire de la plante, elles induisent la formation de nouveaux organes, les nodosités, dans lesquels elles se multiplient et se transforment. Elles deviennent alors capables de réduire l’azote de l’air (N2) en ions ammonium (NH4 +) des composés assimilables par la plante. En contrepartie, la plante fournit aux bactéries une niche écologique et des nutriments nécessaires à leur développement. Aujourd’hui, les équipes de l’Inra, investies dans la recherche fondamentale, étudient les interactions qui s’opèrent entre les deux organismes. Et notamment les mécanismes impliqués dans la symbiose tels que la production de molécules de reconnaissance par la bactérie pour s’identifier auprès de la plante, et peut-être se faire accepter : on sait ainsi que tous les rhizobiums n’interagissent pas avec toutes les légumineuses. Les scientifiques étudient aussi les changements qui s’opèrent au sein de la plante pour accueillir la bactérie, en particulier la formation des nodosités racinaires. Ils s’intéressent également aux programmes génétiques que met en place le rhizobium une fois dans la nodosité, notamment pour parvenir à réduire l’azote en ammoniaque, un processus qui demande énormément d’énergie. La chenille, sensible aux odeurs La noctuelle du coton, Spodoptera littoralis, est un papillon de nuit embarrassant. Sa chenille plutôt, qui cause des dommages très importants aux cultures de coton, maïs, tomates et légumes. L’un des moyens envisagés pour réduire sa nuisance consiste à développer des pièges à base de phéromones mimant l’odeur émise par les femelles adultes, de manière à capturer les mâles avant l’accouplement. Mais dans le cadre d’une stratégie de contrôle globale, il est nécessaire de cibler l’insecte à tous les stades de son développement. À commencer par la chenille. Mais comment savoir ce qui l’attire ? Eh bien ses antennes, bien que toutes petites, possèdent des récepteurs olfactifs, ce qui signifie qu’elle peut, a priori, reconnaître certaines odeurs. Reste à savoir lesquelles, et c’est là que les difficultés commencent. Pas question de faire sentir des milliers de parfums aux chenilles vivantes pour identifier celles qui déclenchent une réaction, cela prendrait un temps fou ! Pour pallier cette difficulté, les chercheurs ont opté pour l’option inverse : partir des récepteurs olfactifs eux-mêmes. En scrutant les informations génétiques de la chenille, ils ont pu établir l’inventaire de ses récepteurs. Puis, ils les ont isolés pour mieux les étudier et tester sur eux tout un panel d’odeurs, bien plus rapidement que ce qu’il est possible de faire en étudiant le comportement. Et ça a marché. Le dispositif a permis d’identifier neuf odorants, qui ont immanquablement attiré les chenilles, vivantes cette fois ! L’expérience démontre que, contrairement à une idée reçue, elles sont capables de faire des choix et de privilégier une odeur plutôt qu’une autre. Ce qui signifie qu’on peut les piéger comme on piège les adultes. Mais les recherches ne sont pas terminées pour autant. La prochaine étape consiste à identifier, par des modèles mathématiques, des déclinaisons des odeurs sélectionnées, encore plus appétissantes que les originales, de manière à améliorer l’efficacité du leurre. Par exemple, pour attirer des chenilles déjà installées sur leur plante de prédilection. Quand l'abeille se rebiffe Varroa destructor : on dirait le nom d’un super vilain de comic book ! Ce n’est pas loin de la vérité, tant ce minuscule acarien, pas plus gros qu’une tête d’épingle, constitue l’un des pires fléaux pour les abeilles domestiques (Apis mellifera). Originaire d’Asie du Sud-Est, le varroa, arrivé en France en 1982, parasite aussi bien les larves que les nymphes ou les abeilles adultes. À ce titre, le varroa est l’un des responsables de la diminution des populations d’abeilles en France et dans le monde. Mais, si le prédateur est présent dans toutes les colonies, certaines se révèlent naturellement résistantes. Pourquoi ? Eh bien parce que leurs abeilles sont capables de repérer les cellules de la ruche qui sont infestées et de tuer les acariens qui s’y trouvent. Et voilà ce qu’a découvert une équipe de l’Inra, à l’issue d’un programme de phénotypage de nombreuses colonies résistantes. Après avoir isolé le caractère impliqué dans la détection du varroa, ils ont identifié les molécules qui déclenchent l’agressivité de l’abeille à son encontre. Un brevet a été déposé, portant sur le développement d’un dispositif permettant aux apiculteurs de repérer très simplement quelles colonies sont résistantes au varroa, et leur permettre ainsi de les sélectionner sur ce caractère. Le sens du sacrifice Décidément, les abeilles ne sont pas à la fête. Déjà affaiblies par les néonicotinoïdes et le varroa, elles sont également menacées par un champignon microscopique originaire d’Asie. Problématique tout au long de l’année, c’est surtout en hiver que Nosema ceranae cause le plus de dommages. En effet, après avoir colonisé les cellules intestinales de son hôte, il dispose de beaucoup de temps pour s’y multiplier et se propager. Les abeilles et la reine sont d’autant plus vulnérables que le champignon semble interagir avec certains pesticides, augmentant leur toxicité. Les ouvrières, infestées par le parasite, présentent en outre des modifications du comportement, passant plus rapidement que prévu au stade de butineuses. Il pourrait s’agir d’une modification induite par Nosema ceranae qui profiterait de l’envol précoce de l’abeille pour aller contaminer d’autres colonies. Mais là encore, des moyens de lutte se dessinent, basés sur l’analyse de colonies résistantes. Alors que le champignon manipule les cellules intestinales afin d’empêcher leur mort, de manière à s’y multiplier durablement, certaines abeilles interrompent ce processus en sacrifiant les cellules contaminées, éliminant l’intrus du même coup. Reste maintenant à identifier les caractères responsables de cet étonnant processus... Les molécules de la parole Les plantes sont de grandes bavardes. Et les chercheurs commencent à peine à décrypter les conversations incessantes qu’elles entretiennent avec leur environnement. De ce point de vue, les plantes aquatiques restent les plus mystérieuses. Pour comprendre de quoi elles parlent, il convient en effet de les observer dans leur milieu naturel. Mais alors, que d’interactions avec les plantes alentour, les insectes et bien sûr les millions de microorganismes présents dans le milieu, qu’ils soient symbiotiques, opportunistes, parasites ou pathogènes. Pour communiquer, les plantes, y compris le phytoplancton, diffusent en permanence un grand nombre de molécules chimiques dont certaines sont propres à une espèce. Toutes ces molécules vont participer à sa défense, ces autres vont attirer d’autres organismes planctoniques, ou entretenir le dialogue avec des champignons symbiotiques. Mais toutes ne s’expriment pas en même temps. Les chercheurs ont ainsi découvert que les plantes coévoluent avec leur environnement et modifient leur communication pour s’adapter aux changements. En outre, certaines molécules ne sont émises que dans des circonstances précises, ou en présence d’autres organismes bien particuliers, qu’il s’agisse de végétaux, d’animaux ou de microbes. Une raison de plus pour préserver la biodiversité, gage d’un formidable réservoir de molécules naturelles. D’autant qu’un grand nombre d’entre elles peuvent se révéler utiles à l’homme. Déjà, certaines montrent des propriétés antioxydantes, antifongiques ou anticancéreuses. Et des travaux sont en cours pour développer des biopesticides comme alternative aux produits phytosanitaires. Mais ce n’est que le début, car si les chercheurs ont identifié deux cent mille molécules, toutes plantes confondues, ils estiment qu’elles pourraient être dix, voire cent fois plus nombreuses ! Le verger rond de Gotheron Produire des fruits avec zéro pesticide, voilà l’ambitieux défi que se sont fixés les chercheurs de l’Inra Gotheron (Drôme) impliqués dans le Projet Z. La méthode utilisée pour y parvenir repose sur l’organisation spatiale des plantes dans l’espace de production, pensée pour limiter l’arrivée, la progression, l’installation et l’impact des bioagresseurs. Première surprise, le verger de 1.5 hectare est rond, une forme choisie pour limiter la surface d’échange avec l’extérieur. Il est cerné par une double haie de 500 mètres de long, notamment constituée d’amandiers et de châtaigniers qui, en plus de son effet brise-vent, est conçue pour retarder la progression des ravageurs. Et en éliminer une partie, puisque des nichoirs à mésanges, des perchoirs à rapaces et des tas de pierre pour accueillir les belettes sont installés le long de cette première barrière. Les bioagresseurs qui la franchissent parviennent à un rang circulaire de pommiers qui jouent le rôle de piège en retenant les pucerons attirés par ce fruit. Les rescapés sont ensuite confrontés à une autre barrière, constituée d’arbres fruitiers variés. Notamment des espèces prospectives telles que la grenade, étudiées dans le contexte du changement climatique. Ce dernier cercle doit protéger les pommiers, pêchers, pruniers et abricotiers situés sur les rangs intérieurs où se concentre l’essentiel de l’espace de production. Les variétés ont été choisies pour leur résistance naturelle aux maladies. Dans cette zone, des plantes attractives et répulsives seront bientôt plantées à intervalles réguliers afin de piéger les insectes qui parviendraient à franchir les obstacles précédents. Des légumineuses sont aussi présentes, qui assureront la fertilité du sol. Enfin, le centre du verger est constitué d’une mare et d’une zone semi-sauvage qui constituent un précieux réservoir de biodiversité fonctionnelle. Le verger, qui vient d’être conçu, arrivera à maturité dans cinq ans et sera évalué durant au moins dix ans supplémentaires. Durant tout ce temps, les chercheurs vont contrôler l’impact de l’agencement spatial dans la maîtrise des bioagresseurs et produire des connaissances sur la façon de construire un tel système. Il est en effet probable que des modifications de l’organisation du verger soient nécessaires afin d’optimiser l’efficacité de l’ensemble des dispositifs. |









 © Photos : Inra/Adobe Stock |
|||||||||
|
||||||||||
